Tome 5 : E comme Eisner. Lotte Eisner. La Cinémathèque française. Le Cinéma de Weimar
(Basé sur des notes de mon Bloc-Notes 2010. Lotte Eisner. Son oeuvre: Conservateur à la Cinémathèque française, historienne du cinéma, spécialiste du film expressionniste allemand et de Fritz Lang. Ses souvenirs: vie artistique de Weimar, Henri Langlois, Stroheim, Nouveau cinéma allemand des années 60)
(Cette note ne suit pas un ordre logique strict et je prie mes lecteurs de m’en excuser. Elle avance au gré de mes études, mes recherches et de mes découvertes. Il y a un fil conducteur pourtant : c’est celui d’une personne passionnée et passionnante comme je les aime, c’est la docteur en histoire de l’art, la journaliste critique de cinéma, la juive allemande devenue française, l’amie fidèle de Henri Langlois, la Conservateur de la Cinémathèque française, la muse des cinéastes allemands d’après-guerre, Lotte Eisner. Un autre fil encore : un autre Allemand, devenu lui américain, son ami, l’auteur génial de Metropolis, celui qui a réussi à faire le lien entre le cinéma allemand de la République de Weimar et celui de Hollywood, Fritz Lang)
Metropolis de Fritz Lang. Découverte de Lotte Eisner.
Metropolis. C’est en février dernier que Arte a retransmis, en live depuis Berlin (à l’occasion de la Berlinale), le film Metropolis dans sa version originale miraculeusement retrouvée en 2008 (miracle à Buenos Aires) et parfaitement restauré depuis lors. C’est avec émerveillement que nous avons suivi, Annie et moi, la première projection mondiale de ce film, d’une durée de deux heures trente, tel que l’avait conçu Fritz Lang en 1926, y découvrant toutes ces innovations que l’on retrouvera ailleurs dans l’évolution ultérieure de l’art cinématographique. Les incroyables mouvements de foules d’abord (25000 figurants), parfaitement maîtrisés : les ouvriers en colère, montant les marches, se déversant dans les salles de machines (on pense à Eisenstein, bien sûr), les foules d’enfants fuyant la montée des eaux, et les magnifiques ballets de leurs bras qui implorent (scènes des pellicules retrouvées à B. A.). Les machines moins réalistes mais plus symboliques que ceux des Temps Modernes, et qui les préfigurent pourtant : mêmes mouvements mécaniques des ouvriers, même servitude, même folie subitement déclenchée des machines qui échappent à tout contrôle, même image hautement symbolique des roues dentées qui s’engrènent. La marche étrangement cadencée des colonnes ouvrières qui se rendent au travail ou qui en sortent (tels des robots), marche qui me rappelle celle du film The Wall des Pink Floyd. L’architecture futuriste de la ville, architecture que l’on va retrouver bien plus tard dans tous les grands films de science-fiction (et dans les BD), la grande tour centrale avec ses terrasses au sommet, la circulation dans l’espace (on pense au 5ème Elément de Besson par exemple). Les scènes de création d’un robot androïde, avec tous les liquides qui bouillonnent dans leurs cornues et les éclairs des décharges électriques, que l’on retrouvera dans tous les films sur Frankenstein. Et puis il y a bien sûr tout ce qui caractérise le cinéma allemand de cette époque, la noirceur, le côté mystique, expressionniste peut-être. Je pense en particulier au personnage tout habillé de noir, factotum du Maître de la Ville, exécuteur de ses basses œuvres, le Mince (der Schmale), mais aussi à la tête de Moloch qui avale ses victimes ou à ce monument dressé à la mémoire de la Femme morte, aimée à la fois par le Maître et par l’Inventeur, et puis aux scènes qui se déroulent dans les catacombes. Il y a une séquence qui m’a littéralement fasciné, c’est celle où Maria est poursuivie dans les ténèbres des sous-sols par l’Inventeur fou muni d’une puissante lampe-torche : elle cherche, épouvantée, à échapper au faisceau lumineux jusqu’au moment où elle se trouve immobilisée, piégée dans une encoignure, collée au mur, les bras écartés, et où le cône de lumière l’atteint au milieu du corps comme si elle était un papillon cloué vivant sur une planche. Sergei Eisenstein Thea von Harbou
Lotte Eisner et le style de Fritz Lang. Et puis, hasard du calendrier, nous sommes à Paris la semaine suivante, et je vois sur l’Officiel des Spectacles qu’un cours de cinéma est organisé (le 19 février) au Forum des Images, intitulé : Bernard Eisenschitz présente : « Notes sur le style de Fritz Lang », de Lotte H. Eisner, 1947 (et j’y cours bien évidemment). Et c’est là que j’entends parler de Lotte Eisner pour la première fois. Et que j’y apprends qu’elle était une journaliste berlinoise, critique de théâtre, historienne d’art, que le Filmkurier avait engagée comme critique de cinéma en 1927. Elle s’intéresse tout de suite à Fritz Lang qui l’invite à assister à une prise de vues nocturne pour le Testament du Dr. Mabuse. Elle quitte l’Allemagne en 1933 (elle est juive) pratiquement en même temps que Fritz Lang, vient en France, y travaille comme journaliste, se lie avec Henri Langlois, va se cacher dans la campagne (du côté de Montpellier) pendant la guerre, s’occupe en même temps des films que lui confie Langlois (et que les Allemands aimeraient bien lui faucher), devient Conservateur de la Cinémathèque dès 1945 et collabore avec Langlois jusqu’à la fin (1976). Elle reprend tout de suite contact avec Fritz Lang après la guerre et publiera plusieurs livres sur lui et sur le cinéma allemand. D’abord en 1952 déjà, chez l’éditeur André Bonne à Paris, une étude sur le cinéma de Weimar intitulée L’écran démoniaque : les influences de Max Reinhardt et de l’expressionnisme. Max Reinhardt était un metteur en scène autrichien qui avait révolutionné la mise en scène des théâtres berlinois avant la guerre (en la dramatisant et en donnant une nouvelle importance au metteur en scène par rapport à l’auteur. J’y reviendrai). Et puis deux monographies sur Murnau et Fritz Lang. Ce dernier livre a été traduit en français par le conférencier, Bernard Eisenschitz, et, dit-il, pas mal influencé par Fritz Lang lui-même qui a été en correspondance constante avec Lotte Eisner pendant sa rédaction. Fritz Lang était son ami et c’est d’ailleurs elle qui est allée en Californie le convaincre de jouer son propre rôle dans le Mépris de Godard qui en était un grand admirateur. De toute façon la critique française s’était intéressée très tôt au cinéma allemand. Eisenschitz cite un article sur Murnau de Roger Blin et un autre sur le style de Fritz Lang du cinéaste Georges Franju paru dans une revue d’avant-guerre, dirigée par Henri Langlois, le Cinématographe.
L’article de Lotte Eisner que nous commente Eisenschitz a paru dans le n°5 de février 1947 de la Revue du Cinéma. Dès les premiers 100 mètres de la pellicule, dit-elle pour commencer, un film de qualité révèle le style de son metteur en scène. Et l’élément le plus important du style de Fritz Lang, pense-t-elle, c’est le rôle de la lumière, « la dramaturgie de la lumière ». Et le premier exemple qu’elle cite est justement cette scène qui m’avait tellement frappé dans Metropolis : la poursuite de Maria par le faisceau lumineux. Le deuxième est tiré de la Rue rouge (Scarlet Street), un film sorti aux Etats-Unis en 1945 mais que visiblement Lotte Eisner connaissait déjà : là c’est une enseigne lumineuse qui flashe à intervalles réguliers comme pour marteler le cerveau malade du caissier assassin. Autre exemple : le Testament du Dr. Mabuse et cette scène nocturne au tournage de laquelle Lotte Eisner avait probablement assisté et où à nouveau une lampe-torche, celle tenue par un policier, cherche à traquer le criminel qui se cache dans les fourrés. Le conférencier nous a d’abord fait projeter les extraits de ces trois films puis de longs extraits de ce magnifique film muet qui date de 1922, les trois Lumières et dont le titre allemand est Der müde Tod (la mort lasse) et le titre anglais : Destiny (et dont j’ai pu acquérir le DVD de la version anglaise dans une boutique spécialisée, Hors-circuits, située rue de Nemours à Paris). On voit la longue montée des marches par celle qui voudrait faire revenir à la vie son fiancé et qui s’approche de la grande figure noire de la Mort et puis pénètre dans la cathédrale remplie de cierges allumés de différentes tailles et qui représentent les vies humaines. Ici cette mer de lumières qui vacillent est une vision presque impressionniste, dit Lotte Eisner. C’est aussi le cas de la séquence déjà mentionnée du Testament du Dr. Mabuse (la poursuite dans les fourrés) car Fritz Lang avait fait arroser les fourrés au préalable pour faire apparaître comme dans un kaléidoscope une multitude de tâches lumineuses. Dans Liliom tourné par Fritz Lang en France en 1933, après son départ d’Allemagne, il cherche à maîtriser la lumière en mouvement. La lumière est à nouveau un élément dramatique important et le metteur en scène s’est donné beaucoup de mal, raconte Lotte Eisner, pour filmer le reflet projeté par les lumières mouvantes du carrousel sur un mur. Et puis les reflets peuvent servir de miroir. C’est ce que l’on constate dans la Femme au Portrait (the Woman in the Window), film tourné aux Etats-Unis en 1944, où le modèle du portrait apparaît soudain dans le tableau illuminé par les phares des automobiles qui passent dans la rue (la femme qui a servi de modèle se tenant furtivement derrière l’homme qui admire le tableau). Mais Fritz Lang s’était déjà servi de ce procédé dans M, le Maudit qu’il avait encore tourné en Allemagne en 1932. Le criminel s’arrête devant une vitrine remplie d’objets brillants (comme une couronne de couteaux) et y aperçoit soudain l’image superposée de l’enfant dont il va faire sa proie. En regardant l’extrait qu’on nous projetait j’ai été fasciné par le jeu de visage de cet acteur prodigieux, Peter Lorre, un acteur de théâtre, nous dit Eisenschitz, que Lotte Eisner a dû connaître très tôt, car il avait déjà joué dans l’Eveil du Printemps de Wedekind sur une scène berlinoise.
L’expressionnisme. Première approche. L’un des auditeurs, au Forum des Images, demandait au conférencier de préciser sa pensée au sujet de l’expressionnisme. Vous avez parlé d’expressionnisme puis d’impressionnisme à propos des 3 Lumières, dit-il. Vous avez également dit que Lang refusait l’étiquette d’expressionniste. Qu’en est-il exactement ? La réponse de Bernard Eisenschitz m’a paru un peu confuse sur le moment. Il a parlé de deux expressionnismes, celui des peintres, celui, plus vaste, qui a marqué différents arts jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Et puis il a répété ce que Lotte Eisner avait dit à ce sujet : Lang se sert de toutes les formes artistiques. Et c’est vrai : dans un autre extrait qui avait été projeté au cours de la séance, un extrait des Nibelungen qui date de 1923-24, on voit Siegfried chevaucher sur un cheval blanc au milieu d’une forêt stylisée par des troncs illuminés par des rais de lumière. Moi, cette image m’a fait penser à une autre forme d’art, le Jugendstil. Plus précisément à un livre de contes de mon enfance, malheureusement perdu, mais dont j’ai retrouvé avec certitude l’illustrateur : Adolf Münzer. Plus tard je découvrirai que c’est un artiste suisse, symboliste, qui avait influencé Lang : Alfred Boecklin. En fait il faudrait revenir à la définition même de l’expressionnisme. Sur le net on trouve : Forme d’art où la réalité est déformée au profit de l’expression… qui privilégie l’intensité de l’expression… courant artistique qui prône une plus grande expressivité du sentiment intérieur... moyens d’expression utilisés sans égard pour la réalité ou la tradition… enfin : recherche de moyens plastiques susceptibles d’exprimer l’émotion à son plus haut degré de résonance. Alors le dilettante que je suis se demande si cette forme d’expression ne peut pas être considérée comme inhérente à ce cinéma naissant, parce que c’est un cinéma muet, un cinéma d’images pur, et qu’elle lui est donc nécessaire, puisque l’absence de dialogues demande forcément une plus grande expressivité dans le jeu des acteurs, dans leur gestuelle, et même dans les objets et les décors qui doivent être signifiants, donc symboliques. D’ailleurs le style de Fritz Lang n’a-t-il pas évolué très naturellement vers une plus grande réalité à partir du moment où il est passé au parlant (dans M, premier film parlant de Lang) ? J’y reviendrai.
Le lendemain, j’ai essayé de le trouver ce fameux article de Lotte Eisner, et je me suis souvenu que la librairie spécialisée en littérature policière, l’Amour du Noir, située rue Cardinal Lemoine, possédait toute une collection de revues sur le cinéma, Cinémathographe (une revue d’avant-guerre éphémère : deux numéros), La Revue du Cinéma qui a déjà existé avant guerre elle aussi et a reparu dès 1946 (en jaune) et ce jusqu’en 1949, ainsi que les fameux Cahiers du Cinéma et Positif qui ont commencé à paraître au début des années 50. Et j’y ai effectivement trouvé ce que je cherchais. La lecture de l’article complet ne m’a pas apporté beaucoup plus que ce que Bernard Eisenschitz nous avait déjà raconté. A la fin de son article Lotte Eisner s’interroge sur ce qu’est devenue l’œuvre de Fritz Lang aux Etats-Unis. A-t-il pu échapper à la dure loi du box office ? « Qu’est-ce qu’un style aussi affirmé que celui de Fritz Lang peut gagner à Hollywood ? », se demande-t-elle. Et au vu des quelques films américains de Lang qu’elle a pu voir après la guerre, elle affirme : « Il semble… que, hormis le dynamique J’ai le droit de vivre (You only live once), ces films aient quelque peu perdu cette vigueur de montage qui renforce encore la puissante construction du découpage et qui caractérisait si magnifiquement Le Maudit. (S’il continue à travailler à ses scénarios, Lang habitué en Europe à tout exécuter lui-même semble avoir dû laisser le soin de monter ses films aux spécialistes des studios californiens). »
Problèmes de montage. C’est effectivement une des nombreuses questions que l’on peut se poser à propos de Fritz Lang. Après être revenu au Luxembourg j’ai rendu visite à la FNAC à Metz pour voir ce qu’ils avaient de disponible en DVD de Fritz Lang et je suis revenu avec M et les Dr. Mabuse d’une part et les deux films jumeaux (mêmes acteurs et scénarios similaires) The Woman in the Window et Scarlet Street, tournés en 1944 et 45. Et j’ai trouvé que ces deux derniers films étaient loin d’avoir le génie des premiers. Et j’ai repensé à l’inquiétude exprimée par Lotte Eisner dans son article de 1947. D’autant plus qu’elle n’est pas la seule à souligner l’importance que Fritz Lang attachait à ces questions. S’il avait d’excellents collaborateurs décorateurs, architectes de décors, opérateurs, électriciens d’éclairage, avec lesquels il collaborait étroitement, il s’occupait lui-même directement du découpage. C’était essentiel pour lui. Et cela me rappelle Eisenstein. J’en avais déjà parlé à propos des caractères chinois (dans mon Voyage, tome 4). Eisenstein avait commencé à apprendre le japonais et avait découvert les caractères chinois. Et il comparait le résultat du travail du montage (élément essentiel pour lui dans le processus de création d’une œuvre d’art) à ce qui se passe avec les idéogrammes : le caractère représente un mot qui est d’abord un son qui a un sens, mais de par sa représentation pictographique, il est également une image qui touche au subconscient, à l’imagination. Et lorsqu’on a une suite de caractères on n’a pas seulement une phrase qui signifie mais une suite d’images qui, se juxtaposant, en créent une nouvelle. « C’est justement ce mode de pensée tout à fait inhabituel qui m’a aidé plus tard à maîtriser la nature du montage», dit-il dans un long chapitre de ses Mémoires intitulé Montage in 1938 (voir n° 3181 Sergei Eisenstein : Notes of a Film Director, édit. Lawrence & Wishart, Londres, 1959). Il y explique comment deux séquences juxtaposées doivent créer et créent en fait quelque chose de nouveau. L’émotion, le thème, l’image du thème que doit percevoir le spectateur. Or, dit Eisenstein, «du point de vue de la dynamique, toute oeuvre d’art est un processus qui fait naître une image dans les sens et l’intelligence du spectateur».
Mais ce n’est peut-être pas aussi simple. Je suis revenu plus tard à la Librairie L’Amour du Noir. On m’avait dit que le jeudi je pourrais y rencontrer quelqu’un qui avait encore connu Fritz Lang en personne. Et je suis effectivement tombé sur Alfred Eibel, écrivain et éditeur, qui a publié un ouvrage sur Fritz Lang en 1964 (Alfred Eibel : Fritz Lang, édit. Présence du Cinéma, 1964) composé essentiellement d’interviews et d’importants textes sur le cinéma de Fritz Lang lui-même. « On m’a envoyé à l’époque le voir à Hollywood parce que j’étais moi-même né à Vienne », me dit-il. Il m’a parlé avec un ton un peu ironique de Lotte Eisner. Dans sa manie de vouloir collectionner absolument tout ce qu’elle pouvait trouver à propos de l’ancien cinéma allemand, elle ramassait quelquefois n’importe quoi, dit-il, même une vieille brouette qui avait servi dans je ne sais plus quel film. A un moment donné, je lui ai parlé de cette histoire de montage et des problèmes rencontrés par Lang dans ce domaine, alors il m’a demandé ce que je pensais de Moonfleet. Génial, lui ai-je dit. « Et bien voilà, et pourtant dans ce film le montage a échappé à Lang totalement », m’a-t-il rétorqué. Et c’est vrai qu’il est génial. Oui, me suis-je dit plus tard, mais cela vient probablement des choix de la mise en scène : chaque fois que l’enfant, le fils de Fox, est présent dans une scène, la caméra se met à son niveau et c’est par les yeux de l’enfant que l’on vit le drame.
Génocide culturel. Mais il n’y a pas que Fritz Lang. Beaucoup d’autres metteurs en scène ont dû quitter l’Allemagne et l’Autriche à cause des nazis ou, étant partis travailler à Hollywood, n’ont pas pu revenir en Allemagne à cause d’eux. Je pense à Robert Siodmak, Billy Wilder, Max Ophüls, Otto Preminger, Ernst Lübitsch, Douglas Sirk, Fred Zinnemann entre autres. Pour chacun d’entre eux il faudrait analyser en détail ce qu’ils ont perdu en venant et en restant aux Etats-Unis et ce qu’ils ont apporté au cinéma américain. Tout n’était pas négatif, bien sûr. Certains ont pu donner libre cours à leur personnalité. Je pense à Billy Wilder par exemple. D’autres ont perdu au change. Et pour l’Allemagne la perte est évidente. D’autant plus qu’il n’y a pas que les metteurs en scène : de nombreux acteurs aussi sont partis, dont Marlene Dietrich, Hedy Lamarr, et Peter Lorre, celui qui a joué le Maudit (il paraît que Lorre, quand la UFA lui a demandé de revenir, leur a envoyé un télégramme avec le texte suivant : « Il n’y a pas assez de place en Allemagne pour deux assassins »). Et beaucoup de techniciens, décorateurs, éclairagistes, opérateurs, caméramen, etc. On estime que plus de 800 personnes travaillant dans l’industrie du cinéma allemand et autrichien ont dû quitter l’Europe (et combien de Français ?). Quelle perte immense sur le plan culturel pour le vieux continent ! Et tous ces réalisateurs ont-ils pu créer ce qu’ils ont voulu, pris dans le système hollywoodien ? Donc nouvelle perte, perte dans l’absolu ! Lotte Eisner a beaucoup reproché à Pabst de ne pas avoir quitté l’Allemagne, mais lui-même a semble-t-il expérimenté le système hollywoodien et ne l’a pas supporté. Il a écrit un livre à ce sujet (mais que je n’ai pas pu trouver) qui porte le titre significatif de Servitude et Grandeur de Hollywood. On peut d’ailleurs se poser la question pour l’ensemble des activités artistiques et culturelles allemandes. Je pense à tous ces peintres (les expressionnistes) considérés comme décadents et ridicules par Hitler et qui n’ont pu continuer de peindre qu’en cachette. Je pense à tous ces écrivains, à Heinrich Mann qui a encore écrit Henri IV sur la Côte d’Azur avant d’aller végéter auprès de son frère en Amérique, à Thomas Mann, complètement dégoûté de son pays qui a longtemps hésité à revenir en Europe, avant de s’installer finalement en Suisse, à Stefan Zweig qui s’est suicidé de désespoir à Petropolis au Brésil, à Alfred Döblin (je suis en train de déguster à petites doses – 2 heures par 2 heures – l’incroyable œuvre cinématographique – 14 heures – que Fassbinder a tirée de ce chef d’œuvre, Berlin, Alexanderplatz, écrit en 1925). Et que dire de tout ce bouillonnement intellectuel, en sociologie, en psychologie, sur la sexualité (j’en ai parlé dans une note de mon Bloc-notes sur Lady Chatterley et D. H. Lawrence à propos des milieux fréquentés par la sœur aînée de Frieda Lawrence). Sur tout cela les nazis ont posé une véritable chape de plomb. Ils l’ont écrasé. Et souvent de manière définitive. Ce n’était pas un génocide, bien sûr, mais une hémorragie et une destruction. Une terrible perte pour l’Allemagne et pour l’Europe. Combien de ces Allemands américains sont-ils revenus dans leur pays après la guerre ? Fritz Lang est, lui, revenu en Allemagne pour tourner encore trois films, ses derniers, le diptyque : Le Tigre du Bengale – Le Tombeau hindou et Le Retour du Dr. Mabuse. Des films qui n’ont pas eu de succès sur le moment et que la critique de l’époque a jugés sévèrement. Il semble qu’aujourd’hui on soit revenu à un meilleur sentiment à leur sujet. Mais je ne peux m’empêcher de penser – même si l’auteur du roman dont ils s’inspirent est le même que celui de Metropolis, Thea von Harbou – qu’ils sont un peu entachés d’hollywoodisme…

Il n’empêche : il faut dire un mot de cette femme, mariée avec Lang de 1922 jusqu’à son départ d’Allemagne en 1933, scénariste de tous ses films de la période et scénariste d’autres cinéastes tels que Murnau et Dreyer, romancière (le Tombeau hindou, une Femme dans la lune et les Espions étaient aussi des romans de Thea avant d’être devenus des scénarios de films) et même actrice. On a dit que Lang l’a quittée parce qu’elle était devenue nazie ce qui ne semble pas correspondre à la vérité puisqu’ils se sont déjà séparés en 1931-32 et qu’elle n’est devenue membre du Parti qu’en 1940. C’est vrai qu’elle s’est bien accommodée du régime hitlérien et qu’elle a continué à travailler pendant la guerre, mais elle ne semble avoir été ni antisémite ni raciste puisqu’elle a vécu – et s’est même mariée – avec un Indien. Après la guerre elle a été emprisonnée brièvement par les Anglais, a participé courageusement avec d’autres femmes au déblaiement de Berlin, puis a repris son travail de scénariste et même de réalisatrice. Elle est morte accidentellement en 1954. C’était une personnalité complexe, pas facile à cerner. De nombreux sites sur le net en parlent. Il y a même un site en allemand qui lui est entièrement consacré et est continuellement mis à jour. Elle avait probablement des défauts mais elle devait être, incontestablement, une femme plutôt exceptionnelle. Je ne sais pas si Fritz Lang est resté en contact avec elle mais je trouve étrange que, lorsqu’il est revenu tourner en Allemagne après la guerre (en 57-58, elle ne vivait plus), il ait justement choisi des romans de Thea von Harbou comme source pour son diptyque du Tombeau hindou et du Tigre du Bengale.
Lotte Eisner, la Cinémathèque et le film expressionniste allemand
C’est ma fille Francine qui m’a d’abord signalé qu’une exposition s’était tenue à la Cinémathèque fin 2006 début 2007 dont l’objet était le cinéma expressionniste allemand, une exposition qu’elle avait visitée et qu’elle avait trouvée absolument « fabuleuse » (ma fille adore Kirchner) et que l’on pouvait toujours la visiter de manière virtuelle sur le site de la Cinémathèque. Alors je me suis effectivement rendu sur le site en question et sur celui de la Bibliothèque de la Cinémathèque et j’y ai trouvé énormément de documents que je me suis empressé d’imprimer : articles, analyses, bibliographie et filmographie, scénarios, listes et monographies de décorateurs, ainsi que de nombreux liens vers les sites d’instituts et de cinémathèques allemands et vers tous les sites qui, dans le monde, s’intéressent au cinéma expressionniste (anglais, américains, australien et français bien sûr). Si après cela quelqu’un a encore le moindre doute sur l’intérêt du net dans le domaine de la culture… Ce qui ne m’a pas empêché d’acquérir le catalogue de l’exposition trouvé à la librairie spécialisée en matière de cinéma (et que j’ai longtemps cherchée car elle se trouvait dans le temps rue Champollion), Ciné Reflets, 14, rue Monsieur le Prince (c’est Monsieur Alfred Eibel rencontré à L’Amour du Noir qui m’avait donné l’adresse). Voir : n° 3943 Le cinéma expressionniste allemand – Splendeurs d’une collection – Ombres et lumières avant la fin du monde, Editions de la Martinière/La Cinémathèque française, 2006.
Film expressionniste ou film noir ? J’ai compris assez rapidement que le problème de la définition de l’expressionnisme n’était pas simple et que chaque critique avait sa propre définition. Tout le monde est d’accord, bien sûr, sur la première définition qui est celle d’un groupe de peintres essentiellement allemands, ceux de la Brücke et du Blaue Reiter (je me souviens d’une exposition extraordinaire, celle de la collection Buchheim, centrée surtout sur la Brücke, organisée à Strasbourg en 1981, voir n° 1543 : Expressionnistes allemands – Collection Buchheim, Musée d’Art moderne de Strasbourg, 28 juin – 23 août 1981, édit. Buchheim Verlag Feldafing, 1981) auxquels il faut bien évidemment ajouter Egon Schiele, l’exposition qui a réuni au Grand Palais les quatre grands Viennois de la Sécession l’a encore démontré d’une manière évidente (voir n° 3452 : Klimt Schiele Moser Kokoschka – Vienne 1900, Galeries du Grand Palais 3 octobre 2005 – 23 janvier 2006, édit. Musées nationaux, 2005). Là où les avis divergent c’est lorsqu’on cherche à étendre la notion d’expressionnisme à d’autres arts dont le cinéma naissant, ou à une forme de pensée, de couleur politique. Rudolf Kurtz qui a été l’un des premiers à étudier l’expressionnisme au cinéma dans un livre publié dès 1926 (Expressionismus und Film) considère ce mouvement comme une « conception du monde » (Weltanschauung), à la fois culturelle et politique. Une « rébellion contre les normes, l’art établi et la bourgeoisie » (mais ceci n’a rien d’original, tous les mouvements de jeunes artistes ont mis en avant ce genre de révoltes). Révolte contre la situation sociale. Réaction aussi contre l’impressionnisme. « Opposition à la réceptivité passive de l’artiste vis-à-vis du réel ». « Attitude volontariste» cherchant à recréer un monde (le « former », le « façonner », le « construire » : en allemand : « gestalten »). Comment appliquer ces théories au cinéma qui est d’abord photographie et donc reproduction du réel ? Par l’architecture et les éclairages, dit Kurtz. Et c’est vrai que les décorateurs-architectes ont joué un rôle essentiel dans le cinéma allemand de cette époque, qu’ils étaient de véritables artistes et que certains de leurs dessins préparatoires sont d’authentiques œuvres d’art. Nous venons de voir, Annie et moi, Le Cabinet du Dr. Caligari que la Cinémathèque de Luxembourg a eu la bonne idée de programmer au début de ce mois. En sortant de là on n’a plus aucun doute : c’est vraiment le film expressionniste par excellence : tout est de travers ! Mais j’ai trouvé aussi que la ville que l’on devine continuellement en arrière-plan faisait penser à certaines vues de villes de peintres expressionnistes (voir p. ex. Maisons en arc de Krumau de Schiele). Quant aux éclairages, on a vu l’importance du jeu de lumières chez Fritz Lang ! Mais, personnellement, je continue à penser que l’expressionnisme qui était l’art dominant dans l’Allemagne des années 20, était particulièrement bien adapté au caractère muet du cinéma débutant. Et il ne faut pas non plus oublier que les artistes de la Brücke se sont également illustrés dans l’art graphique (un art ancien et typiquement allemand qui remonte à Dürer) : la gravure sur bois, l’eau forte et la lithographie (et on peut constater en visitant l’exposition que la Pinacothèque de Paris consacre actuellement au pré-expressionniste Edvard Munch que celui-ci les a également précédés dans les recherches sur ces techniques). Or ce sont encore une fois des formes d’art qui conviennent bien à ce cinéma naissant qui est forcément en noir et blanc.
Un autre critique marquant qui s’est intéressé au cinéma allemand d’avant-guerre est Siegfried Kracauer (Kurtz et Krakauer ont correspondu tous les deux avec Lotte Eisner après la guerre). Voir S. Kracauer : From Caligari to Hitler – A Psychological Theory of the German Film, édit. Princeton University Press, 1947 et S. Kracauer : Theory of film : The Redemption of Physical reality, édit. Oxford University Press, New-York, 1960 (Ce n’est qu’aujourd’hui, c. à d. 50 ans plus tard, que ce dernier livre est traduit en français. Voir le Monde des Livres du 30 avril 2010. Titre de la traduction française : Théorie du Film, la Rédemption de la réalité matérielle, édit. Flammarion, 2010. Or Krakauer n’est pas un simple critique de cinéma, c’est un philosophe et sociologue, analyste original de la modernité. Cela montre une fois de plus la paresse intellectuelle de nos éditeurs et notre esprit désespérément hexagonal !). Krakauer voit dans les films d’avant Hitler « le reflet de la situation politique et économique » de l’Allemagne de la République de Weimar. Voici ce que l’on peut lire sur le site de la Cinémathèque : « Le choc de la défaite, l’inflation et le sentiment d’insécurité, les angoisses devant un avenir incertain, font que la réalité semble s’être transformée en un cauchemar. La peur devant le chaos se traduit en une pathologie de l’âme dont témoignent aussi bien les décors caligaristes avec leurs déformations que la gestuelle stylisée des acteurs ». D’ailleurs Kurtz avait lui aussi noté le fait que « l’ambiance d’une époque en plein bouleversement » pouvait expliquer la naissance du cinéma expressionniste. Je ne suis pas totalement convaincu. Et je me demande si on ne pourrait pas simplement dire que « la situation politique et économique », dont parle Krakauer (on pourrait ajouter psychologique) est simplement à l’origine d’un cinéma noir, dont l’expressionnisme n’est qu’une des variantes. Un cinéma noir ancêtre du cinéma noir américain, voir ci-dessous. De toute façon les films purement expressionnistes ne sont qu’un petit nombre, entre six et neuf selon les critiques, parmi lesquels on trouve, bien sûr, les films de Wiene (surtout Caligari et Raskolnikoff), Nosferatu de Murnau et Metropolis. Alors que sur presque tous les grands films de cette période règne le Mal. Le Mal avec un grand M. C’est une véritable parade de tyrans, dit Kracauer : le Dr. Caligari, le Comte Orlock de Nosferatu, le gouverneur dans Vanina (un film d’Arthur von Gerlach, basé sur une histoire de Stendhal et qui date de 1922), le Dr. Mabuse, Haroun-el-Rachid, Ivan le Terrible et Jack l’Eventreur dans le Cabinet des figures de cire (de Paul Leni - 1924). Mais il y a aussi de grands criminels, des meurtriers en série, des fous. Exemple typique : M, le Maudit. Car le Mal était dans l’esprit du temps. Il préfigurait Hitler. Et beaucoup de ces réalisateurs qui étaient juifs l’ont peut-être plus ressenti que d’autres parce que le Mal, ils le connaissaient bien, il les avait poursuivis pendant toute leur histoire européenne depuis le Moyen-Âge et allait les rattraper une fois de plus de la manière la plus horrible quelques années plus tard. Et c’est cet aspect-là du film allemand d’avant Hitler qui allait avoir l’influence la plus importante sur le cinéma américain (c. à d. sur leur film noir). D’autant plus que la littérature policière américaine avait, de son côté, commencé à évoluer avec Dashiell Hammett (voir l’exposition qui lui a été consacrée récemment à la Bibliothèque des Littératures policières, rue du Cardinal Lemoine, à Paris et la réédition de sa Moisson Rouge) et que le méchant, c'est-à-dire le mal avec un petit m a toujours été une donnée constante du roman populaire (garantissant peur et suspense). Dans une étude du film noir américain que je viens d’emprunter à mon fils Alexandre (comme on le voit je ne me contente pas de voyager dans ma propre bibliothèque, je voyage aussi dans celles de mes enfants), Patrick Brion : Le Film noir, édit. Nathan, Paris, 1991, je lis ceci : « l’apogée du film, à la fin des années trente, est directement liée à la situation économique et sociale de l’Amérique ». « La crise crée le crime ». Il y a donc là un certain parallélisme entre la situation de l’Allemagne et celle de l’Amérique. Si le film noir est avant tout américain, dit encore Patrick Brion, il est aussi « le terrain d’élection des émigrés ». L’influence de ces émigrés, pense-t-il, a surtout été prépondérante dans la photographie. Mais aussi dans l’utilisation du noir et blanc, on y trouve des « réminiscences formelles de l’expressionnisme », « ruelles mal éclairées… docks menaçants, cliniques et asiles… un monde nocturne… ». L’influence européenne, dit-il encore, a été capitale également dans les thèmes : Freud… psychanalyse… héros amnésiques… à la recherche de leur identité… ». Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et d’abord que c’est peut-être grâce à cette influence européenne si essentielle que le film noir américain est encore vivant aujourd’hui, alors que les deux autres genres mythiques hollywoodiens, le Western et la Comédie musicale, ont presque disparu. Et puis si le film allemand de Weimar est lui aussi le résultat de la situation politique et économique de son époque, il n’empêche que le Mal du cinéma allemand était peut-être d’une autre envergure. Et Lotte Eisner n’avait probablement pas tort de parler d’écran démoniaque dans son étude de 1952 (j’y reviendrai), de chercher ses racines dans la culture germanique et de parler de « mysticisme nordique », d’ « emphase romantique », de « fascination pour la mort », de mythe « faustien » et de prédilection pour ce qui est « unheimlich » (à la fois étrange et inquiétant).
Lotte Eisner. Dans le catalogue de l’exposition on trouve une longue note rédigée par l’écrivain et historien du cinéma, Laurent Mannoni, intitulée Lotte H. Eisner, historienne des démons allemands, une note que l’on peut aussi consulter sur le net. Laurent Mannoni qui a connu Lotte Eisner dans sa jeunesse, est aujourd’hui Directeur du patrimoine de la Cinémathèque française et du Conservatoire des techniques cinématographiques (on peut lire une interview de lui sur le site de l’Association française de la photographie cinématographique). L’essentiel de ce qui suit est extrait de l’article de Mannoni.
Lotte Eisner qui était née à Berlin dans une famille juive aisée, avait fait des études d’histoire de l’art (thèse de doctorat sur les images des vases grecs), avant de devenir journaliste, critique de théâtre et finalement de cinéma. Elle était polyglotte (anglais, français et italien en plus de l’allemand) et connaissait le latin et le grec. Elle avait connu Murnau (qu’elle admirait énormément), Fritz Lang, l’acteur Peter Lorre, était devenue l’amie de Bertold Brecht, avait rencontré Eisenstein (déjà très sceptique sur la Révolution soviétique, en 1928) et Louise Brooks qui deviendra son amie après la guerre (Lotte Eisner l’avait vue plongée dans la lecture de Schopenhauer entre les prises de vues de Loulou !). Elle quitte l’Allemagne pour la France en mars 1933, travaille d’abord pour des revues d’exilés allemands, puis pour des journaux français avant de rencontrer deux fous de cinéma qui lui plaisent énormément : Georges Franju et Henri Langlois. Ils avaient déjà créé un ciné-club (en 1935), parlaient de fonder une cinémathèque (en 1936) et puis démarrent une nouvelle revue de cinéma, Cinématographe (1937), à laquelle ils demandent à Lotte de collaborer. C’est la même année, 1937, que Langlois et Eisner rencontrent Erich von Stroheim qui restera un ami fidèle de la Cinémathèque française. La revue Cinématographe a une vie extrêmement brève (deux numéros) mais entre-temps Langlois a réussi à faire comprendre à Lotte Eisner tout l’intérêt qu’il y a à sauver « tout l’univers de création qui accompagnait la naissance et l’avancée du cinéma » (Mannoni). Elle commence alors à travailler pour la nouvelle Cinémathèque. Puis survient la guerre. Lotte Eisner est internée comme Allemande, d’abord au Vel d’Hiv, puis dans un camp du Sud-ouest (j’y reviendrai), s’en évade et va se cacher, aidée par Langlois, dans la région de Montpellier. Langlois lui apportera son soutien pendant toute la durée de la guerre, ce qui explique probablement pourquoi Lotte lui est restée fidèle plus tard, jusqu’au bout, malgré son caractère difficile. Il va même lui procurer un travail : faire l’inventaire des films qu’il a réussi à sauver et à stocker à Figeac, et même obtenir pour elle un certificat de travail officiel sur en-tête de Vichy. Elle-même a changé de nom et s’appelle maintenant Hélène Escoffier. Et puis à la fin de la guerre elle devient Conservateur à la Cinémathèque.
Commence alors « la chasse au trésor », raconte Mannoni. Langlois veut tout. Les films bien sûr, mais tout ce qui les documente : scénarios, décors, photos, etc. Dès le départ il pense à un musée du cinéma. En 1952 Lotte Eisner publie son premier livre (L’écran démoniaque, déjà cité) et marque un sacré point aux yeux de Langlois : il a dans son organisation une universitaire ! Le livre la fait également connaître des spécialistes et de tous ceux qui ont collaboré au cinéma allemand d’avant-guerre. La même année 1952 elle prend la nationalité française. Elle en veut énormément à son pays d’origine. On en reparlera. Mais cela ne l’empêche pas, tout au contraire, de chérir l’ancienne Allemagne qu’elle a connue et ses créateurs. Elle reprend contact avec ceux qui sont partis, Fritz Lang en premier lieu, les critiques de cinéma Kurtz et Kracauer, et puis, en 1953, se rend pour la première fois en Allemagne. Et peu à peu retrouve presque tous les grands décorateurs des films allemands d’avant 1933. Et persuade tout le monde (aussi bien les décorateurs que Fritz Lang, Erich von Stroheim et le frère de Murnau) à fournir tout ce qu’ils peuvent à la Cinémathèque française. Ce serait bien trop long de donner ici tous les détails de cette quête. Un seul exemple suffira : Hermann Warm, le décorateur le plus important de tous (les Allemands parlent d’architecte-décorateur), réfugié en Suisse pendant la guerre, ne lui fournit pas seulement les dessins originaux de Caligari mais va même jusqu’à reconstituer pour Lotte la copie des maquettes originales. Et pourtant lorsque le Musée du Cinéma voulu par Langlois est inauguré en 1972, celui-ci ne mentionne même pas le nom de Lotte Eisner alors qu’il aurait avoué en privé, dit Mannoni : « Les trois quarts du musée, c’est Lotte qui les a apportés ». « J’étais le chien qui rapporte », dit-elle dans ses Mémoires, un peu amère.
Et voilà que se révèle – ce qui a dû être une grande satisfaction pour Lotte Eisner – une nouvelle vague de jeunes cinéastes allemands qui viennent – incroyable paradoxe – en grand pèlerinage à la Cinémathèque française et vénérer celle qui a tant fait pour valoriser le cinéma des grands Allemands d’avant-guerre. En 1974 Werner Herzog lui dédie son Enigme de Kaspar Hauser, et, un peu mystique, se propose de traverser à pied l’Allemagne et la France pour sauver son amie malade (c’est toujours Mannoni qui le raconte). En 1977 c’est Wim Wenders qui lui dédie son Ami américain (un film qu’Annie et moi avons revu récemment à la Cinémathèque de Luxembourg). Rainer Fassbinder était un autre membre de cette nouvelle vague allemande. Je n’ai pas encore fini de voir la totalité de cette œuvre gigantesque (près de 15 heures) qu’il a tirée du roman de Döblin en 1980, mais je trouve – et je suis un peu étonné qu’aucune des critiques du film que j’ai pu consulter sur le net ne le mentionne – qu’il y a un certain rapport entre ce film et ceux de l’époque d’avant Hitler. Peut-être est-ce le sujet si noir du livre lui-même, où ne subsiste aucun espoir, aucune échappatoire, peut-être les décors sombres, les ruelles, les passages, les escaliers, les chambres obscures, peut-être cet acteur gigantesque, Gerhard Lamprecht qui joue Franz Biberkopf, aussi impressionnant que Peter Lorre dans M, peut-être les éclairages, le rouge clignotant des enseignes lumineuses, tout me fait penser une fois de plus à Fritz Lang. Fassbinder est mort d’une overdose quelques années plus tard, en 1983. La même année où est morte Lotte Eisner, âgée de 87 ans.
Laurent Mannoni termine son article écrit à l’occasion de l’exposition de 2006/2007 avec ce bel hommage à Lotte : « L’exposition sur l’expressionnisme présentée par la Cinémathèque française, en son nouveau siège du 51, rue de Bercy, et à l’occasion du 70ème anniversaire de sa création, doit absolument tout à Lotte Eisner. Nul doute que son esprit plane sur les lieux, comme l’ombre de Méphisto dans Faust, le chef-d’œuvre de Murnau ».
L’œuvre critique de Lotte Eisner
C’est encore à la librairie L’Amour du Noir qu’on m’a signalé l’existence d’une échoppe extrêmement intéressante qui se trouve pas loin de la République, 4, rue de Nemours, Paris 11ème : la Librairie-vidéoclub hors-circuits, où, m’avait-on dit, on peut trouver tous les DVD de films classiques ou rares aux meilleurs prix possibles (ils les cherchent dans le monde entier). Et j’y ai effectivement trouvé les Nibelungen de Fritz Lang, la version américaine des Trois Lumières (Der müde Tod) (1921) sous le titre de Destiny, Nosferatu (1922) de Murnau (et même le Nosferatu moderne de Werner Herzog : Nosferatu : Phantom der Nacht de 1979, avec l’inénarrable Kinski et notre Adjani), Loulou (1928) et Die freudlose Gasse (1925) de Pabst, Le Cabinet du Docteur Caligari (1919) de Wiene, (ainsi qu’un autre film, antinazi, de Fritz Lang qui m’intrigue depuis que j’en ai vu des extraits lors de la séance de cours de cinéma de Bernard Eisenschitz au Forum des Images : Man Hunt, qui date de 1941). Hagen Murnau Louise Brooks dans Le Journal d'une fille perdue
L’écran démoniaque. Et puis ma fille Francine m’a apporté l’édition allemande de ce fameux Ecran démoniaque, un livre que lui avait offert (et dédicacé) son prof d’allemand pour la remercier de sa collaboration lors de la création d’un Ciné-Club allemand au sein de l’Uni de Strasbourg en 1986 : Lotte H. Eisner : Die dämonische Leinwand, édit. Fischer Taschen-buch, 1980. Alors commençons par là.
Je ne suis pas certain que le qualificatif de démoniaque soit bien choisi pour des lecteurs francophones. Il fait penser à diabolique ce qu’il n’est pas du tout pour les Allemands. Qui pensent tout de suite à Goethe (il y a plus de choses entre terre et ciel, etc…), au Dr. Faustus, aux forces démoniaques. C’est d’ailleurs ce que Lotte Eisner cherche à montrer, la grande différence qui existe entre le Nord et le Sud. Le Sud et son harmonie méditerranéenne, le Nord et la mystique de la nature et de ses forces cachées (question de climat ? de forêts profondes ? de mer déchaînée ? Divergences entre mythologies scandinaves et mythologies grecques ?). Lotte Eisner cite le fameux Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler où celui-ci parle de l’infinie solitude de l’homme faustien, son aspect nébuleux, son mystérieux clair-obscur (voir : n°2628/29 Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes - Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, édit. C. H. Beck, Munich, 1927. La première édition date de 1917). L’espace où se meut l’âme nordique n’est jamais clair, illuminé, les héros du Walhalla ne sont guère sociables, les dieux qui l’habitent sont inamicaux. Spengler, paraît-il, aimait le brun de Rembrandt, « une couleur protestante », une couleur qui n’existe pas dans l’arc-en-ciel, donc irréelle, couleur de l’âme (l’âme allemande ?), couleur de la transcendance. Avant lui c’était Julius Langbehn, ce funeste promoteur du mouvement Völkisch dont je parle dans mes Trente honteuses (le Völkisch étant une des racines du nazisme), qui a fait l’éloge de Rembrandt (dans un livre intitulé Rembrandt comme éducateur), un « Arien typique » : il recherchait, comme tous les Allemands, aurait-il écrit, le côté mélancolique et sombre de l’existence, l’heure crépusculaire lorsque la nuit paraît encore plus sombre et le jour encore plus clair. Et Hitler, lui aussi, aimait le brun ! Mais je crains que Lotte Eisner qui a écrit cela en 1947 ait été encore trop obnubilée par le souvenir de la marée brune des nazis. Par contre ce qui me paraît vrai c’est que c’est cette mystique nordique qui a influencé le romantisme allemand et que Lotte Eisner a raison quand elle affirme que « le film muet allemand n’est rien d’autre que le développement d’anciennes visions du romantisme allemand ». Il faudrait les relire tous. Relire l’étrange histoire de Peter Schlemihl de Chamisso, celui qui avait vendu son âme au diable et du coup avait perdu son ombre, et tous ces contes de Achim von Arnim, de Wilhelm Hauff (ceux-là ont enchanté mon enfance, je me souviens encore du Gespensterschiff, le Vaisseau fantôme), ceux de E. T. A. Hoffmann aussi, et de tant d’autres. On y trouvera certains contes bien sombres peu faits pour les enfants (et Lotte Eisner nous rappelle que Nosferatu a pour sous-titre : Eine Symphonie des Grauen, une symphonie de l’horreur, et on notera au passage que comme par hasard (?) le mot Grauen signifie à la fois horreur et gris). On notera certains motifs qui caractérisent le romantisme allemand et que l’on retrouve dans le cinéma muet : le miroir (un motif qui parcourt toute l’œuvre de Lang comme un fil rouge), le double, la nuit. Et puis le romantisme allemand s’était enthousiasmé pour la recherche des anciens contes et légendes (voir les Frères Grimm) et même les anciennes chansons populaires (voir Des Knaben Wunderhorn d’Arnim et Chamisso). Roger Caillois, dans son Anthologie du Fantastique, fait une belle place aux Romantiques allemands (voir : n° 1600/1601 Roger Caillois : Anthologie du fantastique, édit. Gallimard, Paris, 1966). Et il me semble qu’il serait peut-être plus juste, plutôt que de parler de romantisme à propos du film muet allemand, de parler de cinéma fantastique. C’est par le style qu’il est influencé par les mouvements artistiques de son époque : expressionnisme et art théâtral. Les thèmes, eux, procèdent du fantastique. Quant à Metropolis (1926) on peut carrément parler de science-fiction. Ce que l’on a appelé plus tard une contre-utopie.
Le film expressionniste par excellence est bien sûr Caligari et tout le monde a en tête l’image (était-ce l’affiche ?) de cette ombre qui court sur les toits avec une femme évanouie dans les bras. Quand Lotte Eisner écrit son Ecran démoniaque, tous les témoins de l’époque du cinéma muet n’avaient pas encore été retrouvés. Pour connaître l’histoire exacte de la genèse de ce film il vaut donc mieux se fier à l’étude de David Robinson parue dans la publication de la Cinémathèque sur le Cinéma expressionniste allemand (voir David Robinson : Le Cabinet du Docteur Caligari – Une genèse controversée). L’historien et spécialiste du cinéma muet qu’est David Robinson explique très bien le rôle respectif, dans cette histoire, des scénaristes, des décorateurs, du metteur en scène et du producteur. Les scénaristes étaient Hans Janowitz et Carl Mayer. C’est Janowitz qui a raconté que c’étaient eux qui avaient imposé le style du film, ce qui est faux. Il n’empêche que Carl Mayer, un Viennois, va encore jouer un rôle important par la suite, en tant que scénariste de beaucoup d’autres cinéastes et en particulier de Murnau. Les deux jeunes scénaristes présentent leur texte au producteur Erich Pommer (Compagnie Decla), encore un Viennois (qui avait d’ailleurs amené le Viennois Fritz Lang à Berlin : on remarquera en passant que tout le cœur artistique et culturel de l’ancienne capitale de la Cacanie est passé avec armes et bagages – c’est aussi le cas du régisseur de théâtre Reinhardt – à l’ancienne capitale du Reich, Berlin). Pommer achète le scénario, intéressé par son côté grand-guignolesque et le confie au metteur en scène Robert Wiene dont on a souvent minimisé le rôle dans la réalisation de ce chef d’œuvre ce qui semble injuste. L’adjoint de Pommer, Meinert présente le scénario au grand chef-décorateur Hermann Warm. Celui-ci en discute pendant une nuit entière avec ses deux aides décorateurs Walter Reimann et Walter Röhrig qui ont tous les deux une formation de peintres. Voici ce qu’en dit Warm : « Reimann, dont les peintures représentaient la technique des artistes expressifs, finit par me convaincre que le thème appelait un style de décor, de costumes, de jeu d’acteurs et de réalisation expressionnistes. » Le lendemain il convainc Wiene, le surlendemain c’est Meinert qui donne son accord. Cette anecdote montre bien l’importance qu’avaient les décorateurs (architectes de décors, peintres-décorateurs, costumiers, etc.) pendant toute cette période du cinéma muet. La publication de la Cinémathèque comprend d’ailleurs un « Abécédaire des Décorateurs » contenant une courte biographie pour chacun d’entre eux ainsi qu’une liste de leurs coopérations cinématographiques. Warm qui avait émigré en Suisse en 1941 et que Lotte Eisner a retrouvé après la guerre a travaillé également pour Fritz Lang, pour Murnau, pour Pabst et pour Carl Dreyer. Et il a refait la maquette des décors de Caligari pour la Cinémathèque française.
Paul Leni qui a réalisé Le Cabinet des Figures de Cire (1924), un autre film expressionniste, était lui-même décorateur et costumier de théâtre. C’est peut-être pour cela, dit Lotte Eisner, qu’il est resté plus que les autres cinéastes marqué par le style expressionniste. Ainsi L’Homme qui rit (est-ce celui de Victor Hugo ?), ce film qu’il a tourné plus tard, en 1928, aux Etats-Unis, garde encore des traces de ses films expressionnistes allemands. On sait que Le Cabinet des Figures de Cire est un film-cadre à trois épisodes comme Der müde Tod (d’où le titre des Trois Lumières en français). Or l’un des épisodes met en scène Ivan le Terrible et Eisenstein s’en est visiblement inspiré (la chambre des tortures et la déformation des corps) pour son propre Ivan le Terrible.
Dans son article de 1947, Notes sur le Style de Fritz Lang, Lotte Eisner avait déjà parlé de l’influence sur le cinéma des années 20 de la mise en scène de Max Reinhardt. Elle y revient dans son Ecran démoniaque. Reinhardt avait deux théâtres à sa disposition (en plus du petit Kammerspiel de 300 places) : le Deutsche Theater qui avait une scène tournante et le Grosse Schauspielhaus qui disposait d’une véritable arène large et profonde. Alors il joue avec la lumière et l’obscurité et utilise les possibilités de ses scènes, l’une tournante, l’autre immense. Un épisode violent apparaît soudain éclairé par des projecteurs puissants puis est de nouveau avalé par l’obscurité. Des mouvements de foules se devinent dans la pénombre et en paraissent d’autant plus menaçants et plus importants. Les projecteurs se croisent, s’éteignent, s’allument, rendent l’atmosphère plus dramatique. Et tous les films, depuis Der müde Tod jusqu’à Metropolis, dit Lotte Eisner, sont marqués par cette scénographie.
Avec Annie nous avons regardé deux soirs de suite les deux épisodes des Nibelungen, la Mort de Siegfried et la Vengeance de Kriemhilde. Lotte Eisner trouve que la première partie est plus stylisée, expressionniste, alors que la deuxième partie est beaucoup plus mouvementée. Ce qui est exact mais c’est aussi lié à l’action, une grande partie de la deuxième partie étant occupée par de grandes scènes de combat. Le plus spectaculaire de ces combats est celui qui se déroule alors que le bâtiment qui abrite les Burgondes est en flammes et que les poutres en feu s’écroulent sur les combattants. On est d’autant plus impressionné que l’on sait que les metteurs en scène étaient encore loin de disposer des moyens de trucage modernes. Encore plus impressionnante est la longue montée des marches vers le Dôme, qui met en scène l’antagonisme des deux reines, Brünhilde et Kriemhilde, l’une noire, l’autre blanche, chacune se prévalant de la gloire de leurs maris respectifs. L’escalier paraît interminable. A tour de rôle l’une des femmes dépasse l’autre, se retourne et la défie. La scène se répète plusieurs fois jusqu’à ce que Kriemhilde, arrivée au paroxysme de la fureur, montre à Brünhilde le collier que Siegfried lui avait arraché lors de sa nuit de noces, lorsque, rendu invisible grâce à la capuche du Nain Niblung, il l’avait vaincu avant de la laisser aux mains du roi Gunther. Je trouve que Fritz Lang démontre là son admirable maîtrise de la mise en scène. On voit littéralement la tension qui s’intensifie, le drame qui monte comme l’escalier jusqu’à son apogée. Or ce moment-là, tous ceux qui connaissent l’histoire, le comprennent immédiatement, déclenche tout le reste : Brünhilde qui va clamer à la face de Günther et de Hagen : « Tue Siegfried ! » Et plus tard après la mort de Siegfried, Kriemhilde qui a épousé, dans le seul but de se venger, Attila le Roi des Huns (comme, si j’osais cette comparaison, Jacqueline Kennedy qui, après l’assassinat de son mari, épouse, pour se venger des Américains, le Grec Onassis), lui dit : « Invite mes frères ! » Et Puis : « Tue-les ! ».
Lotte Eisner, en bonne historienne de l’art qu’elle est, est bien plus frappée par la stylisation adoptée par Fritz Lang : comme le groupe des suiveuses de Brünhilde, habillées en sombre, qui, au début de la montée de l’escalier, s’enfonce comme un coing dans le groupe des suiveuses de Kriemhilde, toute habillées de blanc. Ou Hagen, assis dans l’attente de Kriemhilde, immobile comme une statue, l’épée, posée menaçante sur ses genoux. 
Fritz Lang dit quelque part qu’il n’a pas de style propre (ce qui est faux) mais qu’il adapte son style au thème de chaque film (ce qui est probablement vrai). Les Nibelungen sont la grande épopée des Germains. C’est leur Iliade. Le choix du sujet n’est d’ailleurs pas tout à fait innocent : il n’était pas illogique, dans ces années 20 si sombres pour la nation allemande, de se tourner vers d’anciens mythes et d’anciennes légendes qui sont à la base de leur culture. Et il était logique que Fritz Lang, pour mettre en scène ces héros puissants et durs, choisisse d’en faire une fresque monumentale, une fresque de granite.
En tout cas Lotte Eisner persiste et signe : il y a une continuité certaine dans le style de Fritz Lang. Les caves, les miroirs, par exemple. On y trouve même des miroirs genre téléviseurs, déjà dans Metropolis, et jusqu’à son dernier film, tourné en 1960, qui est aussi le dernier de la série des Mabuse (Die tausend Augen des Dr. Mabuse). Et puis, dès l’origine, il aime le suspense, le fantastique, le noir. Il a aussi le sens de l’humour. Il a introduit la psychologie dans le cinéma allemand. Et le Dr. Mabuse est une vraie réflexion sur son époque, sur la société et sur la criminalité comme l’est M (M, le Maudit en français, tourné en 1931), où il se révèle humaniste, dit Lotte Eisner, et démontre une véritable compréhension pour les réactions psychopathes. D’ailleurs l’un de ses tout premiers films, Die Spinnen (Les Araignées) (1919) était déjà une réflexion sur le jeu du pouvoir, dit-elle encore. Et j’ajouterais que Lang a encore continué à faire une radioscopie de la société dans certains de ses films américains : l’exemple le plus frappant est Fury (1936) où il dissèque ce phénomène typiquement américain qu’est le lynchage. Mais il est vrai qu’il n’est pas le seul cinéaste européen qui, découvrant l’Amérique après y avoir débarqué, décrit, dans ses premiers films tournés là-bas, certains des aspects de la culture américaine qui l’ont choqué (Polanski, Milos Forman, entre autres).

Dans Tartuffe, un type de film que les Allemands désignent sous le nom de film en costume, la caméra explore les physionomies, en fait ressortir la vérité profonde (j’ai toujours pensé que l’une des grandes différences entre théâtre et cinéma était le gros plan). C’est également dans ce film que Murnau a composé, dit Lotte Eisner, une véritable symphonie de portes qui s’ouvrent, s’éclairent (éclairées de l’intérieur), se ferment. Et d’escaliers que montent et descendent les personnages du film. Quant à Faust (1926), c’est le chef d’œuvre du clair-obscur allemand. On y trouve une orchestration sublime, dixit Eisner, de la magie optique. Et puis Murnau est le seul à avoir su maîtriser la création de rythme par le montage. Fritz Lang et la plupart des autres cinéastes préfèrent laisser une scène se dérouler dans toute sa longueur puis suivre avec une autre scène au même rythme. Pabst, lui, préfère des transitions douces laissant une scène se fondre dans la suivante, en gommant en quelque sorte les coupures. Murnau, au contraire joue de la tension que crée le choc de la rencontre de deux scènes qui s’opposent. Murnau est aussi plus symboliste qu’expressionniste, et sur ce plan-là, dit Lotte Eisner, lui et Carl Mayer sont également très proches. D’ailleurs je trouve que ce symbolisme marque tout particulièrement son dernier film, tourné en 1931, Tabou, un film que j’aime beaucoup et que j’ai vu plusieurs fois à la télé (lutte entre ombres et lumières, ces ombres qui représentent le mal, les perles de la grotte défendues par les requins et l’autre perle qui est la virginité de Reri, etc.). Quant au film L’Aurore, dont j’ai le DVD et que j’ai déjà vu il y a fort longtemps, il est considéré par beaucoup de cinéphiles comme faisant partie des plus grands chefs d’œuvre du cinéma mondial. Murnau est mort accidentellement le 10 mars 1931, avant même la première de Tabou, sa voiture ayant quitté la route côtière californienne qui devait le mener à Santa Barbara. Lotte Eisner ne dit rien des difficiles conditions de tournage de ce film et de la déception de Robert Flaherty qui devait être le co-auteur du film. J’en parle parce que j’aime beaucoup Flaherty et surtout sa Louisiana Story (tournée en 1948 pour la Standard Oil) dont les images merveilleuses m’ont marqué à jamais : la rencontre entre le jeune garçon et les ouvriers du pétrole, la plate-forme de forage éclairée dans la nuit tropicale et la vie dans les bayous. Murnau et Flaherty avaient tous les deux souffert du système hollywoodien. Murnau était parti dans les Mers du Sud pour dé-stresser et était tombé sous le charme de la Polynésie (d’ailleurs le véritable titre du film est Tabu, a Story of the South Seas). C’est lui qui avait demandé à Flaherty de collaborer. Mais très vite c’est Murnau qui avait pris les commandes, a tourné, comme à son habitude, en préparant minutieusement le script, cherchant, en un mot, à réaliser un film d’art, alors que Flaherty, en ethnologue qu’il était, aurait préféré improviser et laisser la bride sur le cou aux indigènes. Flaherty est sorti de cette expérience, meurtri et sans le sou. Il se plaignait de la « terrible volonté allemande » de son partenaire, dit Richard Barsam, professeur de cinéma à l’Université de New-York, et spécialiste en cinéma documentaire, voir : n° 2310 Richard Barsam : The Vision of Robert Flaherty, The Artist as Myth and Filmmaker, édit. Indiana University Press, 1988. Murnau avait la majorité de la société qu’ils avaient créée ensemble et a donc pu imposer sa volonté. Les deux cinéastes avaient beaucoup de points en commun (et Murnau admirait beaucoup le film de Flaherty sur les esquimaux, Nanook of the North, 1922). Mais aussi beaucoup trop de différences. Flaherty était beaucoup plus intéressé par l’observation de gens réels dans un environnement réel que par les possibilités d’expression de l’art cinématographique, dit Barsam (encore que j’ai dans la tête les images superbes pas seulement de Louisiana Story mais aussi de Man of Aran). Alors que Murnau était d’abord un artiste et qu’on pouvait difficilement réconcilier l’expressionnisme de l’un avec le réalisme de l’autre. Ils différaient également sur le plan philosophique. Murnau réfléchissait sur la place de l’homme dans l’univers, sur le sens de la vie. Flaherty admirait l’adaptabilité de l’homme à la nature. Murnau voyait l’île polynésienne entourée de forces du mal : tabous inquiétants, dangers de la mer, décadence venue d’ailleurs. Flaherty était Rousseauiste, et croyait au bonheur dans la nature primitive. Murnau était plus sombre, plus intellectuel, européen. La vision de Flaherty était instinctive, optimiste… en un mot américaine !
Dans Le Trésor (Der Schatz) tourné en 1923 Pabst est encore expressionniste, dit Lotte Eisner. Mais tout de suite après ce film il devient réaliste ou naturaliste. Dans La Rue sans joie (Die freudlose Gasse) qui date de 1925, ses décors et ses jeux de lumière sont encore trop artificiels, dit-elle, mais ses autres qualités y sont déjà évidentes : sa façon d’escamoter les coupures entre scènes (alors que Eisenstein et les Russes se servent de la coupure pour mieux dramatiser) et son art de la direction des acteurs, ou plutôt des actrices. Ainsi de Greta Garbo, encore débutante, et d’Astra Nielsen (déjà expérimentée) dans la Rue sans joie. Et puis, un peu plus tard, en 1929, Louise Brooks dans Loulou (Die Büchse der Pandora) et dans le Journal d’une Fille perdue (Tagebuch einer Verlorenen). 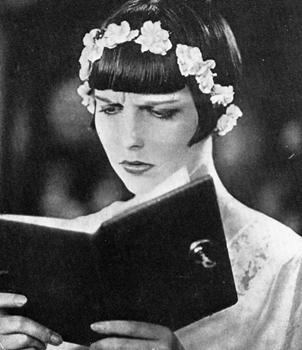
Et pourtant, malgré ces éloges, Lotte Eisner n’aime pas Pabst. Elle ne lui a jamais pardonné de n’avoir pas quitté l’Allemagne à l’avènement de Hitler. Je me demande si elle n’est pas un peu injuste avec lui. Il n’a de toute façon plus rien tourné d’important pendant la guerre (et après la guerre il était malade). Et le livre qu’il a écrit (Servitude et Grandeur de Hollywood, déjà cité) montre, je crois, qu’il connaissait les méthodes hollywoodiennes et qu’elles ne lui convenaient guère.
La décadence du cinéma allemand n’a pas commencé avec l’arrivée des nazis. Elle était déjà en cours avant même l’apparition du parlant, dit Lotte Eisner. Mais elle était devenue une évidence une fois le parlant installé. Des films parlants de qualité comme M (1931), l’Ange bleu de Josef von Sternberg, premier film parlant allemand (1930), l’Opéra de quatre sous de Pabst (1931) et Mädchen in Uniform de Leontine Sagan (1931) ont été des exceptions. Les raisons de cette décadence sont multiples. L’hémorragie constituée par le départ vers Hollywood de nombreux artistes et créateurs est l’une des causes. L’entrée des grands groupes hollywoodiens dans le capital des compagnies cinématographiques allemandes (la tyrannie du box-office) en est une autre. Mais dès avant 1930 le cinéma allemand était devenu un cinéma pour masses : 188 films ont été produits en 1926, 243 en 1927 !
La filmographie de Fritz Lang. Voir n° 3941 Lotte H. Eisner : Fritz Lang, traduction de Bernard Eisenschitz, édit. Cahiers du Cinéma/Editiions de l’Etoile/Cinémathèque française, 1984. Fritz Lang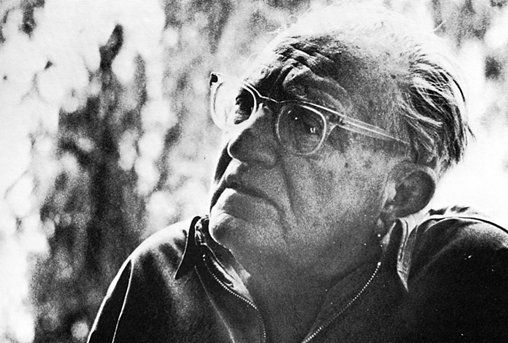
D’abord la période allemande. Premier film d’une certaine importance : Die Spinnen (Les Araignées) (1920). Film d’aventures échevelé dont le script est de Fritz Lang lui-même. Il est possible que la première partie qui s’appelle Der goldene See (Le Lac d’Or) soit inspirée en partie d’un roman de Karl May, dont Fritz Lang, comme d’ailleurs Lotte Eisner, était un lecteur passionné : Schatz im Silbersee (Le Trésor du Lac d’Argent). Mais il y a d’autres in-fluences, surtout dans la deuxième partie, Das Brillantenschiff (dont le titre français est le Vaisseau des Esclaves) : Fenimore Cooper, les films de Feuillade, peut-être même Fu Manchu de Sax Rohmer paru en 1916 (puisque le chef de la bande des Araignées s’appelle Lio Sha). Le thème est un thème classique du roman populaire : une bande dirigée par un chef de génie cherche à se rendre maître du monde, un héros solitaire cherche à l’en empêcher. Une touche personnelle de Lang, dit Simsolo : le thème de la vengeance, un thème « qui poursuivra Fritz Lang tout au long de sa carrière ». Et déjà le souci de l’authenticité : pour décrire les Incas Fritz Lang fait appel à un ethnologue ! Puis viennent des films dont on a déjà parlé. Der müde Tod en 1921, avec Thea von Harbou comme scénariste (elle va d’ailleurs collaborer à tous les films allemands de Fritz Lang qui suivent). Puis, en 1922, le premier des Mabuse qui s’appelle Dr. Mabuse, der Spieler en allemand (Dr. Mabuse, le Joueur) et Le docteur Mabuse dans sa version française. Le film est basé sur un roman-feuilleton de Norbert Jacques. C’est la lutte entre le bandit (financier !) Mabuse et le procureur Wrenck. A la fin de ce premier film Mabuse, devenu fou, est conduit à l’asile. En 1924 Fritz Lang tourne les Nibelungen, puis en 1926 Metropolis. Deux films que j’ai déjà longuement évoqués. En 1927 Fritz Lang, toujours avec Thea comme co-scénariste, tourne son premier film d’espionnage, Spione. Une histoire basée sur un fait réel, une affaire d’espionnage russe à Londres, expliquera Lang plus tard (rapporté par Lotte Eisner). Et comme toujours toute l’activité d’espionnage est parfaitement documentée. Simsolo y voit le prototype du film à suspense genre Hitchcock. « Lang crée la tension dans chaque plan », dit Lotte Eisner. Et elle admire l’économie des moyens (l’accident de chemin de fer dans un tunnel). En 1928 Lang tourne Frau im Mond (La Femme sur la Lune). Encore un film de science-fiction. On pourrait penser que ce n’est que la reprise de la fantaisie, Voyage dans la Lune, de Méliès, dit Lotte Eisner. Il n’en est rien : une fois de plus Lang se documente soigneusement, choisit comme conseillers deux spécialistes, Hermann Oberth et Willy Ley. Les images de la fusée sont tel-lement réalistes, raconte Lotte Eisner, que les nazis retirent plus tard le film de la distribution et détruisent le modèle de l’aéronef (il ne faut pas oublier qu’à peine 9 ans plus tard Wernher von Braun commence à travailler sur les V-1 et les V-2). Et Ley qui est parti ultérieurement aux Etats-Unis (alors que Oberth s’est rallié au régime) raconte que c’est bien Lang qui a inventé le compte à rebours (de 6 à 0 dans le film, un zéro dramatique), le fameux countdown utilisé dans le lancement de toutes les fusées actuelles. Quant à l’histoire elle-même c’est une histoire à l’eau de rose, c. à d. à la Thea (hélas).
Puis viennent les deux premiers films parlants de Fritz Lang : M, en 1931, qui a pour sous-titre : Die Mörder unter uns, c. à d. Les Assassins sont parmi nous (ce qui avait beaucoup inquiété les nazis, pensant qu’on parlait d’eux), et qui est connu dans sa version française sous le titre de M, le Maudit, et puis, en 1932, Das Testament des Dr. Mabuse (Le Testament du Dr. Mabuse). M est un véritable chef d’œuvre. Plus la moindre scorie dans ce film, dit Lotte Eisner. Elle veut dire : plus de sentimentalité à la Thea. Comme on sait, M est l’histoire d’un psychopathe, meurtrier d’enfants.
 |
 |
A Paris il retrouve celui qui l’avait fait venir de Vienne à Berlin, Erich Pommer, l’ancien patron de la Decla, qui lui propose de tourner un film en France. Ce sera Liliom (1933/34), avec les acteurs français Charles Boyer et Madeleine Ozeray (et même, dans un second rôle, Antonin Artaud qui s’était déjà fait remarquer dans la Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer), mais le film n’a guère de succès et dès 1934 Fritz Lang s’embarque pour Hollywood.

Antonin Artaud
Il commence sa carrière américaine avec un film qui m’a beaucoup impressionné quand je l’ai vu à la télé, il y a bien longtemps déjà, Fury (Furie) (1936). Mais avant de parler de ce film il faut mentionner un drame que Fritz Lang a vécu en Allemagne et qui pourrait expliquer certains thèmes qui reviennent systématiquement dans une grande partie de ses films. Lotte Eisner le mentionne brièvement dans son livre sur Lang mais donne un peu plus de détails sur l’affaire dans ses Mémoires. Lang est marié une première fois mais a pour maîtresse Thea von Harbou. Un jour ils font l’amour sur le canapé du salon quand sa femme rentre à l’improviste et les surprend. Elle monte à l’étage et se tue d’un coup de revolver. Lang et Théa sont longuement interrogés par la police qui y trouve certaines circonstances suspectes. D’abord le coup tiré a visé le milieu de la poitrine et non le cœur (mais le coup a quand même été mortel, son cœur étant placé plutôt au centre). Et puis un long laps de temps s’est écoulé entre le coup mortel et le moment où ils ont alerté la police (à partir de ce jour-là Fritz Lang note minutieu-sement tout son emploi du temps et le fait même signer par ses visiteurs). Mais il est possible que cette histoire explique son attirance pour les problèmes de culpabilité (fausse culpabilité ou vraie culpabilité impunie) et de crimes plus ou moins liés à la sexualité, des thèmes qui viennent s’ajouter à un autre thème privilégié par Fritz Lang, la vengeance. Dans Fury, Joe, un honnête Américain, interprété par Spencer Tracy, est pris pour l’auteur d’un kidnapping. Les habitants de la ville veulent le lyncher et mettent le feu à la prison. Joe en réchappe, laisse croire à sa mort et n’a plus qu’une idée : se venger et faire condamner les lyncheurs à mort. A la dernière minute il se repent et se dénonce. Simsolo considère que ce film fait partie avec You only live once (J’ai le droit de vivre) (1937) et You and me (Casier judiciaire) (1938) de ce qu’il appelle une « trilogie sociale ». Dans le deuxième film, You only live once, Eddie, joué par Henry Fonda, est un repris de justice qui veut se réinsérer dans la société. Impossible. Il est condamné pour un crime qu’il n’a pas connu et, au moment où son innocence est reconnue il tue pour s’évader. Dans le 3ème film, un film plutôt raté, un couple de libérés sur parole évite la récidive et va rejoindre la société qui les tolère, ralliant en même temps ses mensonges et son code, dit Simsolo. Dans ces trois films Lang s’est attaqué aux maux de la société américaine, à la violence, au fascisme, à l’hystérie collective mais aussi à ceux de la nature humaine. Et il montre avec virtuosité dans Fury la dualité de l’homme qui passe facilement d’une nature paisible à celle d’un assassin en puissance. Mais Lotte Eisner admire aussi beaucoup le deuxième film qui porte en français, dit-elle, le beau titre de J’ai le droit de vivre. C’est « l’équivalent américain des Trois Lumières ». « L’homme est pris au piège du destin », dit-elle encore. « La femme aimante ne peut arrêter la destinée inexorable de son bien-aimé. Son intervention ne fait que refermer davantage le piège sur lui, et elle doit périr avec lui. » C’est une observation importante car d’une façon générale on a l’impression que les héros de ses films américains sont en général maîtres de leur destin (en tout cas plus que ceux de ses films de la période allemande) et qu'ils sont responsables de leurs actes.
Son dernier film ayant été un échec commercial Fritz Lang a du mal à pouvoir tourner à nouveau jusqu’à ce que Darryl Zanuck lui propose de se mettre au Western. Un cinéaste allemand, récemment installé aux USA, faire un Western ? Pourquoi pas, la mythologie du Western n’est-elle pas universelle ? Et puis Fritz Lang a lu Karl May dans sa jeunesse, il se souvient certainement de Winnetou et de Old Shatterhand. Et, en plus il est allé visiter des tribus indiennes dans les Rocheuses. Alors ce sera The Return of Frank James (Le Retour de Frank James) en 1940 et Western Union (Les pionniers de la Western Union) en 1941. J’ai dû voir le premier de ces deux films, une histoire de vengeance, le thème préféré de Lang : Frank James joué par Henry Fonda, veut tuer l’assassin de son frère. Dans l’autre film, par contre, ce sont deux frères qui s’affrontent jusqu’au duel final mortel. Un film amer, dit Simsolo. Celui qui s’en sort à la fin, le « pied tendre », est l’homme moderne, scientifique et cruel. Ce qui a aussi intéressé Lang dans ces deux films, c’est qu’il y a une nouveauté technique à maîtriser : les deux films sont en couleurs. Et Dieu sait, dit Lotte Eisner, s’il l’a tout de suite maîtrisée. Cela est encore plus évident dans Western Union, dit-elle. Les impressions colorées dans les scènes de nuit, les flammes jaillissantes au milieu des ombres menaçantes dans l’incendie du camp. Et puis il y a encore une autre nouveauté pour Fritz Lang, habitué depuis toujours à filmer en studio : il tourne en extérieurs et prend un plaisir évident, dit Lotte Eisner, à filmer des poursuites. Plus tard, en 1951, Fritz Lang réalisera un troisième western (ce sera dans sa période romantique, dit Simsolo, celle qui englobe aussi Moonfleet, en 1955, un autre film que j’adore et dont j’ai déjà parlé). Ce troisième et dernier western c’est Ranch notorious (L’ange des maudits) avec la somptueuse Marlene Dietrich et Mel Ferrer.

Marlène Dietrich dans Ranch notorious
« Et au plus profond de lui grandit la haine
Le meurtre et la vengeance ».
Et lorsqu’à la fin du film, Marlène Dietrich, « l’Ange » qui règne sur ce ranch maudit, et dont il est tombé amoureux à son tour, se fait tuer pour sauver son amant, Frenchie, et que Vence et Frenchie s'éloignent ensemble sur leurs chevaux, la chanson reprend et se termine ainsi :
« La vengeance est un fruit amer et maléfique
Et la mort lui tient compagnie sur la branche. »
Fritz Lang y montre la vanité de la vengeance, dit Lotte Eisner. Comme dans Fury, mais avec plus de maturité. « Son pessimisme a mûri », dit-elle : « il décrit mieux la complexité de l’existence et l’impossibilité de la réduire à la simple formule du destin implacable ».
En décembre 1941, après Pearl Harbour, la guerre est déclarée entre l’Allemagne et les Etats-Unis et les studios de Hollywood peuvent commencer à participer à l’effort de guerre. Fritz Lang va tourner 4 films anti-nazis. Le premier est Man Hunt (Chasse à l’Homme), tourné en 1941, ce film dont j’ai acquis le DVD, après avoir vu cette image surprenante, projetée par Bernard Eisenschitz, où le capitaine anglais Thorndike, une espèce de gentleman-chasseur, pour l’amour du sport, a Hitler en ligne de mire, mais ne tire pas (son fusil n’est même pas chargé). La Gestapo, par contre, va tout faire pour le rattraper. En 1943 Lang tourne Hangmen also die (Les bourreaux meurent aussi), film basé sur un fait réel, l’assassinat du SS Heydrich par la résistance tchèque. La même année sort The Ministry of Fear (Espions sur la Tamise), tiré du roman éponyme de Graham Greene. Et puis, en 1946, Fritz Lang tourne Cloak and Dagger (Cape et poignard), un film dont le scénario était basé à l’origine sur le personnage de Robert Oppenheimer, le savant qui a été l’un des pères de la bombe atomique américaine. Simsolo trouve qu’il s’agit là d’un « film admirable, injustement méprisé ». Une fois de plus on trouve un thème cher à Lang, celui de notre dualité. Le savant, devenant espion par devoir, quitte la théorie et l’abstraction, dit Simsolo, « pour découvrir la violence et la prostitution ». Et découvrir en même temps sa propre violence (comme le héros de Fury). Lang a raconté à Lotte Eisner que la scène finale du film constituait « un avertissement contre la nouvelle terreur représentée par les capacités destructrices de la bombe » mais qu’elle a été non seulement coupée mais même détruite par la production. Pourtant la scène en question semblait essentielle à Lang. Le nazisme est mort. Mais les idéologies survivent. Et ces idéologies ne permettent pas à l’homme de s’épanouir.
Il y a toute une série de films qui, toujours selon Simsolo, tournent explicitement autour de la psychanalyse à partir de 1944 (il prétend même que le thème était déjà présent dans Cloak and Dagger). Il y a d’abord les deux films jumeaux dont on a déjà parlé : The woman in the window (La femme au portrait) (1944) et Scarlet Street (La rue rouge) (1945). Suit ensuite Secret beyond the door (Le secret derrière la porte) (1948), une histoire de névrosés à la Hitchcock, et puis un excellent film policier dont je me souviens très bien : House by the River (1949). Un écrivain viole sa bonne, la tue, oblige son frère à l’aider à jeter le corps dans la rivière, puis cherche à le faire accuser du meurtre mais ne peut s’empêcher de faire connaître sa propre culpabilité en reprenant l’histoire dans un roman. Il y a de magnifiques clairs-obscurs, ainsi quand les deux frères sortent la barque sous la pluie pour accomplir leur tâche macabre, la lune traverse les nuages et fait briller un poisson qui saute hors de l’eau.
Dans les films qu’il tourne dans les années 50 Fritz Lang reprend d’une manière plus explicite sa critique de la société américaine, dit Simsolo qui classe ces films en deux catégories, l’une de critique sociale, l’autre de réflexion sur les médias. La trilogie sociale est composée de Clash by night (Le démon s’éveille la nuit) (1951), The big heat (Règlement de comptes) (1953) et de Human desire (Désirs humains) (1954). Le premier de ces trois films met en scène le vieux trio mari, femme, amant dans le milieu de la pêche à la sardine de Monterrey cher à Steinbeck, mais je n’y vois pas de véritable critique de la société, ce qui est par contre le cas de The big Heat, un véritable film policier à l’américaine (à vrai dire le premier de Lang) avec gangsters, flics, fric et politiciens. Quant à Human desire c’est un remake, en plus glauque, de La Bête humaine de Zola-Renoir. Un élément d’actualité : Jeff, le conducteur de locos rentre de Corée et en est marqué. Les trois films que Simsolo a placés dans la catégorie médias sont The blue Gardenia (La femme au gardénia) (1952), While the city sleeps (La cinquième victime) (1955) et Beyond a reasonable doubt (L’invraisemblable vérité) (1956). Dans les trois films il y a meurtre et aussi bien dans le premier que dans le troisième il y a cet ancien thème de Fritz Lang, véritable idée fixe, vraie ou fausse culpabilité. Ce n’est que dans le deuxième film que se déploie une critique absolument féroce de l’Empire de la presse. Il y a lutte pour le pouvoir déclenchée par l’héritier (et par là on pourrait penser au Citizen Kane d’Orson Welles de 1940, qui est, me semble-t-il, mais il faudrait le revoir, plus un film sur le pouvoir que sur les médias. Je note que le magnat de presse de Lang a presque le même nom : Keane). Mais chez Fritz Lang, l’héritier du magnat met en concurrence ses trois chefs de département, et l’objet de cette concurrence c’est la découverte d’un meurtrier. Et pour y réussir tout est bon : délation, corruption, prostitution et beaucoup de cruauté. Le crime est bon pour la presse. Pour elle le crime paye. Le portrait est terrifiant, dit Simsolo.
Voilà donc la carrière américaine de Fritz Lang bouclée. Et plutôt que de parler encore de ses trois derniers films, ceux de la seconde période allemande, je pense qu’il est plus intéressant de s’interroger et éventuellement de tirer quelques conclusions. Que Fritz Lang soit un très grand metteur en scène, un parmi les tout grands, me paraît évident. Ce qui m’intéresse ici c’est de mieux connaître l’homme Lang. Et pourtant, arrivé à ce point de mon étude, je suis pris de doutes. Je trouve que Simsolo utilise un peu trop souvent la notion de critique sociale. Il est certain que Fritz Lang connaît parfaitement les tares de la société américaine, le « cancer de l’Amérique », comme il dit, « l’égoïsme et l’appât du gain ». Et il a montré ces tares chaque fois qu’il en a eu l’occasion. Mais Lang n’est pas un cinéaste politique, il n’est pas Costa Gavras, il n’a fait ni Z, ni Etat de siège. C’est certainement un homme de gauche (mais il n’a jamais été marxiste, il n’a d’ailleurs guère eu à souffrir du maccarthysme), un démocrate qui sait de quoi le fascisme et le totalitarisme sont capables et qui se méfie énormément du dévoiement du pouvoir. Un anarchiste ? Peut-être. Un individualiste certainement. Qui ne s’est jamais incliné devant personne. Mais ce qu’il ne cesse jamais de montrer dans ses films ce sont les faiblesses et les vices de la nature humaine. C’est là qu’il faut chercher, me semble-t-il, la vérité de Fritz Lang.
Lotte Eisner, à propos de certains films, cite à plusieurs reprises le théâtre grec et la fatalité antique. Pour You only live twice, Lotte Eisner utilise même le terme grec d’ananké : « on laisse les pauvres se rendre coupables et puis on les laisse à leur culpabilité ». A 16 ans Eddie s’est battu avec un autre garçon qui s’était montré cruel, il a été envoyé en maison de redressement, entraîné sur le mauvais chemin, condamné, puis libéré, mais on ne l’a plus jamais laissé s’intégrer dans la Société. Ce premier faux pas qui est la cause de tout, un coup de pied du destin, est un motif typiquement langien, dit Lotte Eisner : « once off guard » (un moment de relâchement). Et le dernier coup du destin se produit à la fin du film, lorsque le couple en fuite arrive à la frontière canadienne et que la femme va chercher des cigarettes à un distributeur automatique et… est reconnue. Mais sinon, comme on l’a déjà dit, les personnages langiens de ses films américains sont en général responsables de leurs actes. Si on étudiait statistiquement les 22 films qu’il a tournés aux Etats-Unis, je suis certain que dans au moins 90% d’entre eux on trouverait un ou plusieurs meurtres. Il s’est expliqué là-dessus dans un texte de 1947 qu’il avait communiqué à Lotte Eisner : « Le meurtre prend sa source dans les ténèbres du cœur humain… La civilisation peut bien nous avoir apprivoisés, avoir infléchi nos désirs destructeurs dans l’intérêt de la société, mais il reste encore en la plupart d’entre nous beaucoup de la créature sauvage et sans inhibition, bien assez pour nous identifier momentanément au hors-la-loi. Le désir de blesser, le désir de tuer sont étroitement liés au besoin sexuel, sous l’emprise duquel aucun homme n’agit raisonnablement. Notre répugnance même est la preuve de l’angoisse sous-jacente que chacun peut se transformer en assassin, de la peur qu’un jour, une fois – sous l’empire de circonstances qui saperont la barrière édifiée par des siècles de civilisation – vous ou moi, nous pourrons être cette personne ». C’est ce qu’il prouve d’ailleurs dans plusieurs de ses films lorsque des gens tout à fait ordinaires sont amenés à vivre des circonstances qui les rendent violents, pleins de haine et capables de tuer (pour se venger, pour éviter d’être tués, etc.). Voir le héros de Fury qui n’a plus qu’une seule idée en tête : la mort pour ceux qui ont essayé de le lyncher, et qui, une fois la tension passée, ne sera plus jamais le même qu’avant. Il en est de même du savant qui s’est révélé capable de tuer lui aussi, entraîné par patriotisme dans une guerre d’espionnage sans merci dans Cloak and Dagger. Ou le Cross de Scarlet Street lui, l’éternel soumis, qui après avoir été capable de tuer Kitty et de laisser un autre, le souteneur de Kitty, être condamné pour son crime, n’est plus qu’un clochard, un mort vivant. Tout ceci me fait plutôt penser, au Heart of Darkness de Conrad et à ce chef de station devenu fou, Kurtz (qu’on retrouve d’ailleurs dans Apocalypse now): « La sauvagerie avait murmuré des choses sur lui-même qu’il ne savait pas, des choses dont il n’avait pas eu l’idée avant de prendre conseil de cette immense solitude - et le murmure s’était montré d’une fascination irrésistible ». Et puis on pense à Freud, bien sûr. Je suis certain que le Viennois Fritz Lang connaît à fond son Viennois Sigmund Freud. Et peut-être même ces propos échangés par le vieux Sigmund avec son ami Stefan Zweig lorsqu’ils se retrouvent tous les deux en 1939, réfugiés sur l’île britannique et voient leurs vieux pays de culture submergés par la barbarie. Des propos très proches des mots utilisés par Fritz Lang dans son article de 1947. « On l’avait toujours traité de pessimiste», disait Freud à Zweig, « parce qu’il avait nié le pouvoir de la culture sur les instincts (voir son livre: Unbehagen in der Kultur que j’ai déjà cité à plusieurs reprises dans mon Voyage à propos du tueur de Beyrouth dans Littérature méditerranéenne et de l’explorateur et ethnologue Richard Burton dans les Mille et une Nuits), maintenant on voyait confirmée de la façon la plus terrible, son opinion que la barbarie, l’instinct élémentaire de la destruction ne pouvaient être extirpés de l’âme humaine». «Peut-être», continuait-il, «trouverait-on le moyen de réprimer ces instincts au moins dans la vie des Nations. Mais sur le plan individuel, jamais. Dans la vie de tous les jours, dans la nature la plus intime, subsisteraient comme des forces indéracinables et peut-être nécessaires pour maintenir l’indispensable tension.» C’était bien l’intime conviction de Fritz Lang…
Les Mémoires de Lotte Eisner
Lotte Eisner
Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.
Es war ein Traum.
Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch
(Man glaubt es kaum,
wie gut es klang) das Wort: "ich liebe dich!"
Es war ein Traum.
(J’avais, jadis, une belle patrie. Le chêne y poussait grand et fort. Les douces violettes inclinaient leurs têtes. C’était un rêve. Elle m’a embrassé. En allemand. Et elle m’a dit ces mots, en allemand (si doux, on a peine à le croire) : « Je t’aime ». C’était un rêve.).
C’est aux alentours des années 1830 que Heine a écrit ce poème, intitulé In der Ferne (à l’Etranger), qui fait partie de ses Neue Gedichte. Peu de temps après, en 1833, tous ses écrits furent interdits en Prusse et, en 1935, dans tous les Etats allemands, Autriche comprise. A partir de ce moment il adoptera un ton beaucoup plus agressif et persifleur, même si dans son dernier grand poème, Deutschland, ein Wintermärchen (voir n° 0052 Heinrich Heine : Gedichte, édit. Insel-Verlag, Francfort, 1968), il mélange encore souvent l’émotion à la satire (je pense en particulier à ces vers où il évoque ce conte de la belle princesse qui a dû céder sa place à sa sorcière de servante, qui converse encore tristement avec la tête coupée de son cheval qui parle et qui peigne ses longs cheveux d’or, assise seule sur la lande. Je les ai cités dans mon Voyage au tome 2 au chapitre Contes de Fées :
«Wie pochte mein Herz, wenn die alte Frau
Von der Königstochter erzählte,
Die einsam auf der Heide sass
Und die goldenen Haare strählte...»
Je me suis souvent demandé ce que l’on pouvait éprouver quand votre patrie vous avait rejeté. Comme nos protestants français après l’abolition de l’Edit de Nantes, comme Heine au XIXème siècle et comme, au XXème siècle, les anti-nazis et surtout tous ces juifs allemands qui n’étaient pas seulement vomis par leur patrie mais carrément voués par elle à l’extermination. Je n’ai pas l’impression que les Huguenots aient gardé beaucoup de sympathie pour leur ancien pays. Beaucoup d’entre eux sont devenus d’excellents officiers prussiens qui ont combattu la France. En Afrique du Sud ils n’ont rien conservé de la culture française à part celle de la vigne (je me souviens d’avoir engagé un dirigeant pour notre filiale sud-africaine qui portait le beau nom de François Duplessis mais ne parlait pas un mot de français et n’avait absolument pas la moindre curiosité pour le pays de ses lointains ancêtres). Et pourtant j’ai souvent rencontré dans mon étude des Trente honteuses (voir mon Voyage, tome 4) des Allemands, juifs, qui restent ou reviennent, attachés malgré tout à la langue et l’ancienne culture. Est-ce parce que notre amour de la patrie à la française est trop intellectuel, rationnel (parle à notre raison) et que l’amour de la patrie allemand est plus sentimental (parle au cœur, aux tripes) ? Voyez Victor Klemperer qui a vécu jusqu’au bout en juif marié à une non-juive sous le régime nazi, subissant les humiliations les plus incroyables et les plus insupportables, tous les jours la peur au ventre, qui déclare souvent qu’il ne sera plus jamais allemand. Et en même temps, et jusqu’à la fin, que personne ne peut lui enlever sa germanité. Voyez Fritz Stern, devenu américain, et qui revient pourtant en Allemagne, ami du Président Weizsäcker, de Helmut Schmit et Marion Dönhoff, qui, tout en demandant constamment aux Allemands de ne jamais oublier ce qui s’est passé car c’est une tache qui restera à jamais attachée à leur histoire, est aussi quelqu’un qui a fait la paix avec son ancien pays et qui regarde vers l’avenir. Regardez Marcel Reich-Ranicki, expulsé comme Polonais, enfermé dans le ghetto de Varsovie, réussissant à deux reprises à sortir sa femme des rangs de ceux que l’on envoie aux camps de la mort, arrivant finalement à sortir du ghetto, sauvant sa vie mais ayant perdu toute sa famille à Auschwitz, et qui revient en Allemagne, toujours aussi amoureux de la littérature allemande, de sa langue, jusqu’à devenir le pape de la critique littéraire dans son pays. Voyez un écrivain tchèque de langue allemande comme Leo Perutz, parti s’installer en Israël et revenu en Autriche pour y habiter, y finir sa vie et y être enterré. La patrie pour tous ces gens-là ce ne sont pas seulement les paysages, les filles, les anciens contes que chante Heine. C’est l’ancienne culture, l’ancienne littérature, la langue. Pour les Canetti, juifs du Danube bulgare, la langue allemande était la langue de la culture (et se rendre en Allemagne c’était se rendre en Europe). Et pour Lotte Eisner qui a perdu sa mère dans les camps d’extermination sa patrie c’était toujours l’Allemagne intellectuelle et artistique d’avant Hitler, son théâtre, son cinéma, ses créateurs. Henri Langlois
Lotte et l’Allemagne de Weimar. Que peut encore nous apprendre ce livre de Mémoires alors que l’article de Manonni contenait déjà une biographie plutôt complète de notre Lotte ? D’abord il nous révèle son caractère : son nom de famille fait penser au mot allemand Eisen qui signifie fer, or elle a vraiment une volonté de fer, elle est restée ce garçon manqué qui, après avoir lu Winnetou, voulait être une Peau rouge (son père, bourgeois très conservateur, lui interdit pourtant la lecture de Karl May quand il apprend qu’il a fait de la prison), une âme d’homme dans un corps de femme qui déteste les femmes (ou plutôt méprise la plupart d’entre elles, ainsi d’ailleurs que sa mère et sa jeune sœur, bien trop frivoles à ses yeux). Une femme fidèle (voir sa fidélité à Henri Langlois et la Cinémathèque), une femme idéaliste (l’amour du cinéma allemand et de la vieille culture allemande), une femme modeste, mais obstinée, une femme bien attachante.
Intéressant aussi de l’écouter parler de sa jeunesse à Berlin et de sa famille. Une famille bourgeoise allemande et juive, tellement intégrée dans la société allemande que l’on se rend compte une fois de plus, non seulement de l’horreur de l’extermination, mais surtout de l’énorme absurdité de l’exclusion de ces membres éminents de la nation. Le père est nationaliste, adore le vieil Empereur, participe à la Totenwache (la veillée mortuaire) à sa mort, encourage son fils à s’engager comme volontaire lors de la déclaration de la guerre de 14. Il ne va à la Synagogue qu’une fois par an (la Fête du Pardon dont il aime la signification), sinon on suit plutôt les traditions chrétiennes, on fête Noël, et les enfants vont à l’Ecole protestante (en somme on suit l’enseignement du philosophe berlinois Moses Mendelssohn qui prône l’assimilation au point qu’il a fait baptiser ses enfants). On élève les enfants dans la grande culture allemande mais aussi européenne (importance de Victor Hugo), la gouvernante est anglaise. On oblige son fils Fritz à prendre la suite du père dans les affaires (le père est marchand de tissus en gros, le grand-père était banquier), mais Fritz se ménage toujours une place pour une activité intellectuelle à côté de son activité économique (qu’il continue encore après son exil à Londres). C’est ainsi que le frère adoré de Lotte développe une véritable passion pour Heinrich Heine, au point de devenir un des grands spécialistes du poète (lorsque paraît la grande édition centenaire de Heine dans le Akademie-Verlag de Berlin, 4 volumes de lettres et de commentaires sont dus à Fritz Eisner).
Mais comme on est toujours le juif ou le nègre de quelqu’un, la famille Eisner, qui habite le quartier chic du Tiergartenviertel (le quartier du zoo), ne se lie guère avec les juifs, petits commerçants, les nouveaux riches de l’époque (d’où sort Lubitsch), qui habitent le Kurfürstendamm. Et elle a le plus grand mépris pour les juifs d’Europe centrale, mais plus tard, lorsqu’à Paris la réfugiée Lotte Eisner est mise en contact avec les familles bourgeoises juives parisiennes, celles-ci la considèrent à leur tour comme une juive d’Europe centrale, raconte-t-elle. Dans L’écran démoniaque Lotte Eisner, qui ne semble pas avoir une haute estime pour les films allemands de Lubitsch, dit que sa légèreté berlinoise « s’est affinée aux Etats-Unis ». Et elle dit que le Berlin de l’époque offrait un amusant mélange entre une ironie latine héritée des Huguenots, l’esprit juif très intellectuel et le Galgenhumor (l’humour noir, mais le mot allemand est plus explicite et signifie l’humour des potences) qui est la sagesse des ghettos des juifs d’Europe centrale.
Lotte Eisner commence à étudier à Berlin la philosophie et l’histoire de l’art, puis va à Fribourg (où il y a moins de distractions qu’à Berlin, dit-elle) continuer l’histoire de l’art avec un professeur éminent, Curtius, le quitte pour Munich étudier l’archéologie, pour enfin passer une thèse de doctorat à l’Université de Rostock en Allemagne du Nord. Sujet : l’évolution des images sur les vases grecs. Mais la pratique de l’archéologie ne l’excite guère. C’est ainsi que revenue à Berlin elle fréquente les artistes et s’intéresse au journalisme, travaille d’abord pour la Berliner Zeitung, pour enfin, en 1927, passer au Film-Kurier. Et, en même temps, son centre d’intérêt va passer du théâtre au cinéma.
Mais son expérience du théâtre lui servira quand il s’agira d’étudier et d’évaluer le nouvel art cinématographique. Elle parle encore en détail, dans ses Mémoires, de Max Reinhardt et de ses mises en scène. Et aussi de Bertold Brecht. Elle a été très tôt en admiration, dit-elle, devant ses pièces et ses mises en scène, très différentes de celles de Reinhardt. Elle l’a rencontré pour la première fois en 1921, mais avait déjà pu lire un de ses manuscrits en 1920 (il avait 22 ans), celui de sa première pièce Baal, encore très lyrique, et en est complètement remuée (une puissance dramatique extraordinaire, une poésie sauvage et violente, des mots pointus, des phrases coupantes et une langue finalement très proche du langage familier, dit-elle). Elle est restée l’amie de Brecht pour le reste de sa vie.
Et elle nous décrit cette période de l’après-guerre et l’importance prise très vite par le cinéma. L’inflation était terminée en 1924, dit-elle, mais la passion pour le cinéma est restée. L’UFA dont l’origine remontait à 1917 et dont l’actionnaire principal était la Deutsche Bank, avait créé toute une chaîne de salles de cinéma. A Berlin l’industrie cinématographique emploie, en 1928, 12500 salariés. Mais, ajoute-t-elle, la grande masse des films ne valait pas grand-chose. Et puis l’exode commence très tôt. Lubitsch quitte en 1923 déjà, puis Murnau, Leni et beaucoup d’autres. Bientôt ne resteront plus que les deux ennemis face à face : Lang et Pabst.
Elle raconte également le retentissement qu’a eu à Berlin la présentation, en 1926 (le film avait été tourné en 1925), du Cuirassé Potemkine. L’importance que le film d’Eisenstein avait eue pour l’intelligentsia allemande de gauche (et elle et son frère en faisaient partie), une intelligentsia qui avait perdu tout espoir dans la Révolution après les répressions sanglantes des Républiques des conseils ouvriers de 1919 (lorsqu’elle arrive à Munich, on lui demande si elle est une parente du Eisner, Président de l’éphémère République de Munich. Non, dit-elle, hélas. J’aurais pourtant été honorée d’être sa parente). L’importance aussi du film sur le plan artistique. Les acteurs : naturels, populaires, personnages bruts de la rue ou de la campagne. Le montage : filmique et non théâtral. Tout à coup on comprend que c’est le rythme du film qui compte pour le montage, et non la chronologie d’une scène de théâtre. C’est bête, dit-elle, mais il fallait y penser. Elle rencontre Eisenstein en personne en 1928. Un homme très cultivé, dit-elle, qui a beaucoup lu, doué en langues, et plein d’humour. Elle raconte aussi l’histoire du fiasco de Viva Mexico et le rôle pas très glorieux qu’y joue le grand écrivain « socialiste » américain, pourtant si fier de sa position toujours très morale et moralisateur pour les autres – quant à l’alcoolisme par exemple, de London et de beaucoup d’autres - l’écrivain Upton Sinclair (un aspect de l’histoire que je ne connaissais pas et dont Eisenstein ne parle pas dans son livre déjà cité, Notes of a Film Director). Sinclair finance le film. Mais, bien avant qu’il ne soit terminé, Staline exige qu’Eisenstein rentre en Russie soviétique. Eisenstein hésite, mais il reste communiste, et surtout russe, et ne veut pas vivre une vie d’exilé. Alors il rentre, en passant par Berlin où Lotte Eisner peut longuement s’expliquer avec lui en 1932. Il est déjà très désabusé par le système stalinien. Il espère néanmoins que Sinclair va lui envoyer les bobines tournées et qu’il pourra en entreprendre le montage en Russie. Mais Sinclair a peur de ne pas rentrer dans ses fonds. Il garde les morceaux filmés. Et les vend séparément.
Dans la République de Weimar l’ambiance devient plus pesante après 1928. La censure est plus sévère. Le film de Pabst, le Journal d’une Fille perdue, est interdit. Les groupes radicaux d’extrême droite sont de plus en plus visibles. Lotte Eisner est directement attaquée dans la presse nazie (le fameux Völkische Beobachter écrit à propos de Lotte : « Quand les têtes commenceront à rouler, celle-là roulera avec les autres »). Et puis l’arrivée du son, dit-elle, diminue encore la qualité du cinéma de masse. Le Weimar artistique évolue mal.
La guerre. Il y a une autre histoire qu’elle raconte et qui n’est pas à la gloire de la France, c’est celle du camp de Gurs. Au moment de la déclaration de la guerre elle est emprisonnée comme tous les Allemands de France. Ce qui peut se comprendre (après tout elle a la nationalité allemande et peut être une espionne ! le vieux mythe français de la 5ème colonne). Les Américains sont allés encore plus loin en mettant dans des camps les citoyens américains dont l’origine ethnique était japonaise. Et, pendant la guerre de 14, les policiers français sont allés chercher Albert Schweitzer et sa femme à Lambaréné et l’ont amené dans un camp dans le sud-ouest où il est resté emprisonné jusqu’à la fin de la guerre. Parce qu’il était allemand. Comme tous les Alsaciens. Par la faute d’un traité passé au-dessus de leur tête et légalisé par un vote de l’Assemblée nationale, malgré la protestation émouvante de tous les élus alsaciens. Mais laissons cela et oublions les vieux griefs. Lotte Eisner est d’abord internée au Vél d’Hiv puis transféré à ce camp de Gurs (près de Pau) qui avait été créé pour les réfugiés espagnols anti-franquistes. Les conditions d’hygiène et de nourriture sont épouvantables. Et quand Lotte Eisner qui perd ses dents à cause du régime alimentaire, se rend chez un dentiste elle voit, tout seul dans un enclos entouré de fil de fer barbelé, un Espagnol sans bras et sans jambes. « Voilà une image », dit-elle, « que je ne pardonnerai jamais aux Français ». Elle-même réussira à fuir de ce camp qui se révélera un véritable piège pour tous les juifs et les opposants politiques allemands qui s’y trouvent. Car, au moment de l’armistice les internés ne sont pas libérés et les Nazis n’ont plus qu’à venir s’y servir. C’est ainsi qu’elle rencontrera après la guerre un ami opérateur de cinéma, opposant à Hitler, qui a été ramassé à Gurs et a passé toute la guerre dans un camp de concentration.
Henri Langlois. Lotte Eisner raconte aussi la façon dont elle a survécu, après son évasion, grâce à de faux papiers, et au soutien constant et attentionné de Henri Langlois auquel elle rend hommage. Il s’est mis en danger pour moi, dit-elle. Une fois que j’étais installée à Figeac, il est venu me voir tous les trois mois. Le résultat : une amitié indéfectible, portée par notre amour commun pour le cinéma. Il faut dire que Henri Langlois devait être une personnalité complètement hors normes. Un personnage mythique, rayonnant, un peu oriental, peut-être (enfance passée à Smyrne). Devenu obèse avec le temps, formant un couple un peu monstrueux avec sa femme Mary Meerson (qui cherchait à l’éloigner aussi bien de Lotte Eisner que de l’autre collaboratrice précieuse de la Cinémathèque, Marie Epstein, sœur du cinéaste Jean Epstein). Son mythe dépassait largement les limites de l’hexagone car il avait vraiment été un pionnier dans la collection et l’archivage des films. Il avait commencé avant la guerre à ramasser tous les vieux films français qu’il pouvait trouver : L’Herbier, Abel Gance, Jean Epstein, Marcel Carné, René Clair, Jacques Feyder mais très vite sa quête allait s’étendre aux films du monde entier. La Cinémathèque de Langlois était devenue une Cinémathèque du Monde, dit-elle. Et c’est également lui qui a eu l’idée de créer une espèce de bourse d’échanges avec les autres musées de films naissants. C’est ainsi qu’est née la FIAF (Fédération internationale des Archives de Films) qu’il a présidée et dont le nombre de membres était de 4 avant la guerre et est monté à 60 dans les années d’après-guerre.
Et alors Lotte Eisner raconte la fameuse affaire Langlois. Je m’en souviens. C’était un grand scandale à l’époque. L’époque de Malraux. La Cinémathèque était une institution privée mais avait reçu de fortes subventions entre 1958 et 68. Grâce à ces aides l’Etat était représenté majoritairement au Conseil de Surveillance de la Cinémathèque. Or Langlois refusait de donner au Ministre de tutelle non seulement des indications sur l’utilisation des fonds mais même les listes d’inventaires de films. Il paraît que Jean-Louis Barrault a dit qu’il était le serviteur de l’Etat mais pas son domestique. Langlois aurait pu dire la même chose, dit Lotte. Sauf que Langlois n’était en rien un serviteur de l’Etat. C’est devenu alors une épreuve de force personnelle entre Malraux et Langlois. Malraux a cherché un prétexte : les conditions de stockage des films. Mauvais prétexte, dit Lotte Eisner. Langlois avait depuis longtemps demandé de pouvoir étendre ses capacités de stockage. Et puis il reçoit un stock de films documentaires sur la dernière guerre d’un vieux dépôt situé à Nîmes. Les films arrivent à Bois d’Arcy au moment où la commission d’enquête s’y rend pour l’évaluation. Or ils sont dans un état épouvantable. Le résultat de la commission est biaisé. Et Malraux qui a la majorité au Conseil, licencie Langlois ainsi que ses collaboratrices directes, Lotte Eisner et Marie Epstein. Et nomme un homme de paille à la tête de la Cinémathèque, un certain Barbin. Immédiatement c’est la révolte. Renoir et Resnais créent un comité de défense auquel tous les cinéastes français participent, sans aucune exception, aussi bien ceux de la Nouvelle Vague qui se disent « les enfants de la Cinémathèque », que les anciens comme Carné et Clouzot. Une vague de protestations internationales déferle sur la France : Russes et Américains, Japonais et Indiens, Anglais et Danois, etc. Fritz Lang envoie un long télégramme en français : « Profondément outré par scandaleux et grossier renvoi de Henri Langlois qui a consacré toute sa vie à la Cinémathèque Française dont les magnifiques résultats sont unanimement reconnus uniques par le monde entier grâce à son travail dévoué stop cette grande institution créé (sic) par lui périra sans lui stop… J’interdis… la projection de mes films à la Cinémathèque jusqu’à nouvel order (sic) » Et c’est ce que font tous ceux qui n’ont remis leurs films que dans un but de conservation et d’exposition. Le Musée du Cinéma était devenu vide.
Lotte Eisner nous raconte les manifestations. Elle marche bras dessus bras dessous dans le cortège avec Simone Signoret quand celle-ci crie : les CRS ! Elles courent se réfugier et rencontrent un peu plus tard Godard qui saigne de la tête et a ses fameuses lunettes noires brisées (Truffaut aussi a reçu des coups de matraque). BB était également dans le cortège, Jean Marais aussi et même le vieux Michel Simon. Et tous les cinéastes étrangers sollicités ont envoyé des télégrammes de protestation comme celui de Fritz Lang (sauf ces salauds de Hitchcock et Sternberg, dit-elle). Plus tard Truffaut et Godard inscrivent sur la façade du Palais de Chaillot à la peinture phosphorescente : Malraux = Goebbels. Même les chauffeurs de taxis le soutenaient, raconte-t-elle : j’ai même vu, de mes yeux vu, un chauffeur de taxi refuser d’être payé pour sa course, disant : non Monsieur Langlois, pour vous c’est gratuit !
Langlois a été rétabli dans ses fonctions bien sûr. L’affaire avait duré exactement 75 jours. Et il a continué son travail après cela comme si de rien était. Mais le gouvernement le lui a fait payer très cher. Plus de subventions. Alors que la Cinémathèque, en 1968, comptait 60 collaborateurs. Ses seules rentrées allaient être les aides privées et les recettes des séances cinématographiques. Langlois a eu une fin de vie difficile. Il a encore subi beaucoup d’attaques personnelles. Et il avait complètement négligé ses propres intérêts. Il n’avait même plus de quoi payer son électricité et son téléphone. Le jour de sa mort quand il a voulu téléphoner à des amis, son téléphone était coupé ! Avec Henri Langlois, dit Lotte Eisner, c’est l’âme de la Cinémathèque qui est morte…
Erich von Stroheim. Lotte Eisner était connue, elle aussi, et appréciée, par tous les amis de la Cinémathèque à travers le monde. Elle avait des relations d’amitié avec les metteurs en scène américains Nicholas Ray (dont la mort a été filmée par Wim Wenders dans Nicks Movie), King Vidor (que Henri Langlois a reçu en grandes pompes – avec limousine – quand il a été invité à Paris par Jack Lang pour la remise de la légion d’honneur et dont la Cinémathèque a alors montré un de ses vieux films, Show People) et John Ford (qui a visité la Cinémathèque de nombreuses fois et à qui Lotte Eisner, fanatique lectrice de Winnetou, a reproché la façon dont il a traité les Indiens dans ses films). Mais c’était surtout Stroheim que Lotte Eisner chérissait énormément. Erich von Stroheim était venu en France au milieu des années trente, complètement dégoûté par Hollywood. Il y a beaucoup de gens qui ne voient en lui que l’acteur alors qu’il était un metteur en scène original et peut-être même génial. Je me souviens avoir découvert ici, à la Cinémathèque de Luxembourg, son Wedding March et que ce film m’avait beaucoup impressionné. Mais Stroheim a été véritablement détruit par Hollywood en même temps que ses films.
Lotte Eisner raconte entre autres l’histoire de ce qui aurait certainement été son chef d’œuvre, et même un chef d’œuvre universel, Greed (Les Rapaces), à l’instar du grand film de Griffith, The Birth of a Nation. A l’origine le film durait 8 heures puis il a été coupé et re-découpé jusqu’à ce qu’il n’en reste rien. Henri Langlois et Lotte Eisner ont cherché pendant des années les bobines originales. Jusqu’à ce qu’ils ont appris beaucoup plus tard, en 1962, que la MGM les avait détruites pour faire de la place (le nom qui était collé dessus était celui du titre du bouquin dont le scénario était tiré). Stroheim n’a jamais eu le droit de toucher au montage de ses films. Or Langlois avait sauvé ce qu’il avait pu de ses films défigurés et rêvait de lui donner l’opportunité de les remonter à sa guise. Des 24 bobines de Greed il n’en restait plus que dix. Langlois, Lotte Eisner et Mary Meerson étaient présents lorsqu’ils lui ont projeté les restes : le grand Stroheim en pleurait. Alors ils lui ont donné la possibilité de remonter son Wedding March et de le sonoriser à nouveau. Il y a travaillé jour et nuit avec sa femme et une coupeuse de l’équipe de Langlois, puis le film, dans sa nouvelle version, a été projetée dans une des salles de la Cinémathèque et le public lui a fait un triomphe. Mais, hélas, aucun producteur en France, n’a eu le courage de lui donner une nouvelle chance. Même si un réalisateur comme Renoir l’a traité avec énormément de respect quand il l’a fait tourner dans la Grande Illusion. C’était un grand seigneur et qui savait jouer au grand seigneur à la perfection. A Paris il vivait dans un château, le château de Maurepas, avec sa femme l’actrice Denise Vernac, qui lui était complètement dévouée, avec valet de chambre, bonne et cuisinière ainsi qu’une Cadillac blanche, alors qu’il était noyé de dettes, mais sa femme le lui a caché jusqu’au dernier jour. Devant son bureau, dit-elle, était posée à la place d’un fauteuil une selle brodée avec ses étriers, des épées ciselées ornaient les murs et lorsque Langlois et Eisner vont le voir juste avant l’arrivée de René Clair qui devait lui remettre la Légion d’Honneur, il était couché en robe de chambre de soie noire sur son lit recouvert de satin rouge. Dans le numéro de la revue Positif qui lui consacre un dossier spécial (n° 385 de mars 1993), on s’étend longuement sur le fait qu’il n’était pas noble mais fils d’un chapelier juif de Vienne et qu’il n’avait pas non plus été officier d’un régiment de l’Empereur de Cacanie mais un simple caporal qui avait déserté pour se rendre en Amérique. Quelle importance, dit Lotte Eisner, et je suis bien d’accord avec elle. Et je l’admire d’autant plus qu’il a réussi à le faire croire à tous les Américains ! Lorsqu’il est mort peu de temps après (en mai 1957), raconte Lotte, on aurait dit que c’est encore lui qui a organisé la mise en scène de son enterrement : juste avant que le long et solennel cortège funèbre arrive à l’église une troupe de vaches furieuses réussit à rompre un enclos et se mélange à tous ses amis qui étaient venus lui rendre un dernier hommage !
Lotte et l’Allemagne d’après-guerre. Il reste à parler des relations de Lotte Eisner avec la nouvelle Allemagne. Ce n’est qu’en 1953 qu’elle s’y rend pour la première fois. Avec énormément de réticences. Sous son nom français de Louise Escoffier. Ne voulant rencontrer que des gens dont elle sait qu’ils n’étaient pas mouillés avec le régime nazi. Car pour elle le monde s’était divisé en deux : d’une part ceux qui y ont participé et les autres. Il faut dire que les Allemands, non plus, ne regardent pas les émigrés avec beaucoup de sympathie. Fritz Lang, quand il commence à tourner ses films indiens, voit ses studios maculés d’inscriptions : Yankee, go home. Et Marlène Dietrich, raconte-t-elle, s’est même fait cracher dessus quand elle s’est promenée dans les rues de Hambourg. D’ailleurs je me souviens des propos haineux émis par certains de ses adversaires politiques à l’encontre du Chancelier Willy Brandt : on lui reprochait de ne pas avoir partagé les souffrances des Allemands pendant la guerre, d’avoir émigré en Norvège et même d’avoir pris la nationalité norvégienne. Je crois qu’il faut bien comprendre que la première réaction des Allemands dans l’immédiat après-guerre était l’humiliation de la défaite totale et de la destruction complète du pays. Et la révolte contre les souffrances subies, les bombardements, le souci du lendemain. Et pour ceux de l’Est les viols des femmes allemandes par les soldats russes (le dernier carnet de guerre d’Ernst Jünger en est rempli – voir n° 3774 Ernst Jünger : La cabane dans les vignes, Journal IV 1945-48, édit. Christian Bourgeois, 1980 – alors qu’il était beaucoup moins prolixe sur les massacres perpétrés par les Allemands en Europe centrale dont il était pourtant parfaitement informé). Il était trop tôt pour que la masse de la population se rende vraiment compte de la responsabilité collective de la nation. Nous-mêmes, les autres Européens, n’avons-nous pas mis dix ans avant de vraiment prendre toute la mesure et saisir l’horreur du génocide juif ? Et puis trop de gens avaient été eux-mêmes pris par la folie nazie, avaient cru jusqu’à la fin à une victoire possible (Victor Klemperer raconte comment des gens, alors qu’ils fuient Dresde en direction de la Bavière, dans les tout derniers jours de la guerre, croient encore que Hitler est innocent, que ce sont ses acolytes qui sont responsables, croient à la dernière Vergeltungswaffe, l’arme de la revanche, la V3 ou V4, qui permettra à l’Allemagne de gagner la guerre). Beaucoup étaient peut-être encore restés nazis (alors que j’avais pris une chambre chez un particulier pour mieux surveiller notre filiale allemande de Bergisch-Gladbach mon hôte me racontait qu’il avait été fait prisonnier en Afrique du Nord et transféré dans un camp de prisonniers au Texas, et qu’il en gardait surtout deux souvenirs : d’abord que ce n’est qu’après avoir vu les énormes stocks de matériels de guerre qui passaient en train ou étaient parqués à perte de vue dans la plaine qu’il a compris que l’Allemagne n’avait absolument pas la moindre chance de gagner la guerre, et, ensuite, que dans les camps de prisonniers les nazis, s’appuyant surtout sur les anciens SS, continuaient à faire la loi, empêchaient toute fraternisation avec les gardiens, organisaient des tribunaux et même, des mises à mort, tous ceci à l’insu des Américains). Conclusion : il fallait attendre qu’une nouvelle génération apparaisse, plus consciente des fautes des pères, et les juge.
De plus, dit Lotte Eisner, on avait l’impression que toute vie intellectuelle était morte. Le miracle économique l’avait tuée. Aussi grande fut sa surprise - et sa satisfaction - quand elle découvre les jeunes réalisateurs des années 60. Je ne connais pas le premier film qu’elle cite, Lebenszeichen (Signe de vie) de Werner Herzog. Elle semble avoir été la seule, dit-elle, qui a reconnu dans ce film une nouvelle d’Achim von Arnim. C’est par un retour au vieux romantisme allemand que l’on fait la liaison avec l’ancien cinéma d’avant-guerre, dit-elle encore. Et elle le dit à Fritz Lang qui ne la croit guère. Plus rien de bon ne peut venir d’Allemagne, dit-il. Et puis elle rencontre Werner Herzog à Cannes (en 1969 ?) où elle se rend tous les ans (pour organiser la programmation et les rétrospectives de la Cinémathèque). Et c’est tout de suite le coup de foudre. C’est Herzog qui lui donne le surnom, à la mode paysanne de Bavière, de la « Eisnerin ». Mais les premiers films de ces jeunes Allemands ne sont pas forcément romantiques (sauf peut-être pour ce qui est de la forme ?). Beaucoup d’entre eux règlent les comptes avec leurs anciens. Je me souviens en particulier des Scènes de chasse en Basse-Bavière (Jagdszenen aus Niederbayern) de Peter Fleischmann. Mais il y avait aussi Rainer-Werner Fassbinder, mort il y a longtemps déjà, Alexander Kluge, Werner Schroeter que Henri Langlois appréciait beaucoup, paraît-il, et qui vient de disparaître (voir Le Monde du 14 avril 2010) et puis Wim Wenders et Werner Herzog qui continuent à produire encore aujourd’hui.
C’est d’ailleurs Werner Herzog qui a écrit la préface aux Mémoires de Lotte Eisner. Nous étions une génération d’orphelins, dit-il. Nous n’avions pas de pères auxquels nous pouvions nous référer. Seulement des grands-pères : Murnau, Lang, Pabst. Les cinéastes des autres pays européens ne peuvent comprendre cela. Nous, nous avons vécu un vide, une rupture, de près d’un quart de siècle, dus à la barbarie nazie, cette guerre catastrophique et la désolation de l’immédiat après-guerre. Mais, finalement nous avons trouvé notre chemin. Et nous avons retrouvé une certaine légitimité. Mais comme les anciens Empereurs du Saint Empire n’ont obtenu leur légitimité ultime qu’après avoir été consacrés par le pape, nous-mêmes nous n’étions sûrs de notre véritable légitimité, qu’après avoir été approuvés par celle qui constituait pour nous la dernière autorité, la Eisnerin. Elle était le dernier mammouth, bousculé par un siècle terrible et violent, mais qui lui avait survécu. Ses livres sur le film expressionniste, sur Murnau, sur Fritz Lang, son activité auprès de la Cinémathèque française, consacrée au sauvetage et à la reconnaissance de notre héritage culturel commun, et finalement ces Mémoires auxquels elle a travaillé jusqu’au dernier jour de sa vie et qui la complètent, tout ceci constitue le legs qu’elle nous laisse.
Et Martje Grohmann qui a également fait la connaissance de Lotte Eisner au festival de Cannes où elle l’a ensuite rencontrée chaque année (et souvent aussi à Paris dans son appartement, ses parties de thé) et l’a finalement aidée à publier ces Mémoires, en dessine, elle aussi, un portrait chaleureux. Jusqu’à la fin elle a conservé une curiosité insatiable pour le cinéma, dit-elle. A Cannes elle courait les salles de projection, toujours à la recherche des nouveautés. Les journalistes allemands se battaient pour l’interviewer. Car comme le dit Herzog, c’est elle qui était devenue, après la disparition de Henri Langlois, l’histoire vivante du cinéma. A la fin de ses Mémoires Lotte Eisner a des réflexions curieuses en ce qui concerne les langues. Elle-même était polyglotte et, aux tea-parties dans son appartement elle passait indifféremment du français à l’anglais, à l’allemand (avec Martje Grohmann) et même à l’italien pour parler avec sa bonne portugaise. Chaque langue enrichit les autres, dit-elle, et elle citait Heinrich Heine qui, lorsque Gérard de Nerval, qui le traduisait en français, lui disait à propos d’un mot : « cela ne peut pas se dire en français », lui répondait : « alors j’en fais cadeau aux Français, de ce mot ! ». Mais à propos de l’Allemagne et de sa langue maternelle elle dit quelque chose qui me paraît tout à fait significatif. Il faut savoir que patrie se dit Vaterland en allemand, pays paternel. Je ne sais pas, dit-elle, pourquoi on dit langue maternelle (Muttersprache). Car pour moi le Vaterland c’est la Vatersprache. Le pays de mon père c’est la langue de mon père. Belle formulation…
(mai 2010)
PS (novembre 2014) : Nous venons de revoir avec toujours le même plaisir Paris, Texas, le chef d'oeuvre de Wim Wenders, et découvert qu'apparaît en grand, dès le début du générique, tout seul au milieu de l'écran : Dédicacé à Lotte Eisner